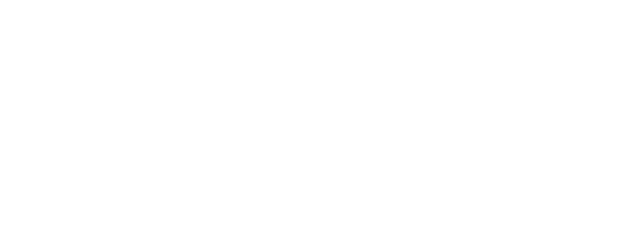Ce soir n'est pas une nuit comme les autres. La nouvelle lune et les épais nuages de l'orage qui approche ont laissé le camp dans l'obscurité totale. C'est comme si Dieu avait éteint les lumières du ciel pour s'endormir lui aussi.
Le silence règne sur la plaine près de la barrière frontalière. Les enfants se reposent, épuisés, mais c'est la nuit "D" et il n'y aura peut-être pas d'autre occasion comme celle-ci de sauter avant qui sait quand.
Chérie, réveille-toi, c'est l'heure", murmure-je à l'oreille de ma femme qui dort blottie contre Fatima, notre enfant de quatre ans, que j'avais recouverte d'une bâche en plastique pour la protéger de la rosée.
-J'arrive ! J'arrive ! C'est l'heure ! C'est l'heure ! -s'écrie-t-elle, en s'asseyant, effrayée et désorientée, la paume de sa main pressée contre sa poitrine, comme pour essayer d'empêcher son cœur, qui bat à cent à l'heure, de lui briser les côtes.
Pardonnez-moi, je ne voulais pas vous effrayer. Que vous est-il arrivé ? Vous avez fait un cauchemar ?
-Un cauchemar ? N'importe quel cauchemar aurait été meilleur que cette réalité de merde.
En entendant notre conversation, la fille ouvre les yeux, écarte la bâche en plastique de fortune pour bien nous voir, nous sourit et les referme, comme si de rien n'était.
-Allez, finis de te lever, je vais réveiller les autres", préviens ma femme en allant réveiller les familles voisines qui, à leur tour, se réveillent les unes les autres.
Il n'y a pas de sac à dos à préparer, tout est tombé à l'eau. Nos seuls biens sont nos vies, que nous avons réussi à préserver au prix de grands efforts, et celles de nos familles. Notre seul objectif : traverser la frontière, la ligne qui sépare la mort certaine de la vie. Mais ils n'allaient pas nous faciliter la tâche. Nous sommes trop nombreux et le pays utilise son "droit au contrôle de l'immigration" pour justifier la violence contre ceux qui, comme nous, tentent d'entrer illégalement, comme nous avons l'intention de le faire ce soir. Dans ma famille, nous avons toujours respecté le dicton selon lequel lorsque trois personnes mangent, quatre mangent ; mais certaines personnes ne semblent pas se mettre cela dans la tête dans les circonstances actuelles.
Malgré le fait que nous ne pouvons presque rien voir et que tout le monde obéit aux instructions sur la nécessité de se taire, dans leur propre intérêt, le bourdonnement causé par le mouvement des quelque 400 personnes du groupe peut être dangereux. Je cours donc trouver Obama, le chef du dernier groupe de familles à nous rejoindre, pour voir s'ils sont prêts. Il n'aime pas ce surnom, mais son peuple le lui a donné pour les avoir entraînés dans le cri de "Sí se puede" (Oui, nous le pouvons).
C'est l'heure, on ne peut plus attendre", dis-je en lui offrant ma main pour l'aider à se relever.
Mais nous sommes encore fatigués", répond-il en se levant, en prenant soin de ne pas réveiller sa femme, qui se repose à ses côtés. Certains de nos gens ont à peine dormi deux heures après trois nuits.
-Je sais, mais on ne peut pas prendre le risque. Les conditions sont optimales, la visibilité est nulle, je peux à peine te voir devant moi.
-Je comprends, mais je ne me porte pas garant de la force de mon peuple. Nous ferons ce que nous pourrons.
C'est ce que nous ferons tous, Obama, ce que nous pouvons", dis-je en le prenant fermement par les deux bras et en le secouant pour l'encourager. Arriver jusqu'ici a déjà été un miracle. Si tu ne viens pas avec nous, tu vas tout gâcher, car qui sait quand nous aurons à nouveau une nuit comme celle-ci. De plus, si tu ne viens pas, tu devras reculer de quelques kilomètres pour ne pas être découvert lorsque nous ferons le saut.
-Retournez-vous, même pas pour prendre de l'élan, mon ami, répond-il avec une lueur particulière dans l'œil, vous pouvez compter sur nous !
Nous prévoyons d'attaquer la clôture dans la zone de Nahr Saghir, car elle se trouve à mi-chemin entre les deux points de contrôle les plus éloignés de la clôture. Nous devrions arriver avant 4 heures du matin, car à cette heure-là, les gardes font généralement une pause café et se réveillent pour le reste de la nuit. Nous voulons les prendre le plus au dépourvu possible, alors nous partons sans crainte. La terreur dont nous sommes issus a été si intense que risquer notre vie dans un saut semble être un jeu d'enfant. Nous devons passer par cette épreuve et tout ce que nous voulons, c'est qu'elle se termine le plus vite possible.
Ainsi, dès notre arrivée, nous commençons la manœuvre comme prévu. Deux équipes, équipées de cisailles, étaient chargées d'ouvrir deux trous dans le premier grillage. Pour franchir la deuxième clôture, les jeunes ont fabriqué deux échelles avec de la ferraille trouvée dans les environs, mais elles sont restées fermes et sûres. Nous avons répété le mouvement des centaines de fois : monter rapidement, sans s'arrêter, mais sans pousser. Les premiers à monter placent des bâches sur les concertinas pour minimiser leur pouvoir de coupe. Une fois en haut, ils doivent sauter de l'autre côté et, en se tenant fermement à la clôture, descendre à une hauteur à partir de laquelle la chute est acceptable et, une fois de retour au sol, sortir rapidement pour éviter d'être écrasé par ceux qui arrivent derrière.
Le plan est exécuté à la perfection. En à peine cinq minutes, les premières familles gravissent déjà les marches de la deuxième clôture sans attirer l'attention de la police des frontières. La coupure mondiale d'Internet a rendu les caméras de surveillance thermique et les détecteurs de mouvement inutilisables, ce qui nous donne un certain avantage. En fait, c'est notre principal atout. Mais les choses semblent commencer à se gâter car l'orage a fait sa redoutable apparition. De forts éclairs transforment la nuit en jour, nous laissant à la merci des gardes, qui ne tardent pas à nous découvrir. L'alarme commence cependant à sonner lorsque plus de la moitié du groupe est déjà passée de l'autre côté.
Le protocole était clair : une fois la barrière franchie, nous devions tous courir et entrer dans la ville, sans nous retourner, pour éviter d'être renvoyés dans le feu de l'action. Tout le monde sauf moi, qui doit retourner vérifier combien d'entre nous ont finalement réussi et aider les retardataires. Alors, dès que nous trouvons la première voiture derrière laquelle nous cacher, je m'arrête un instant avec ma femme.
-Tu vas bien, tu as des coupures ou des bleus ? -Je demande alors que la fille lâche ma main et court se blottir contre les jambes de sa mère qui l'inspecte de haut en bas à la recherche de blessures.
-Non, mon amour, tout est parfait. Et Fatima ?
Fatima était une championne, n'est-ce pas ? Elle s'est accrochée à mon cou pendant qu'on répétait, aussi fort qu'elle le pouvait, et ne m'a lâché que lorsque nous sommes descendus et avons commencé à courir. Comme elle court, maman !
-Bien sûr, papa, répond fièrement la petite fille. Quand je serai grande, je serai une coureuse et je gagnerai beaucoup de courses.
-Je suis sûre que tu le feras, mon amour, tu seras une championne olympique, tu verras", répond sa mère en nous serrant dans ses bras et en nous embrassant tous les deux. Dieu merci, nous allons tous bien.
-Oui, Dieu merci, mais arrêtons de parler et séparons-nous. Vous ne serez pas tout à fait en sécurité avant d'arriver en ville.
-Ne t'inquiète pas, chérie, nous savons où nous devons aller. On se retrouve là-bas dans un petit moment. Je sais que tu dois y retourner, mais ne prends pas plus de risques que nécessaire.
-Je te promets que je reviens tout de suite, ma chérie", dis-je en la serrant dans mes bras. "T'ai-je jamais menti ?
Alors que les deux femmes de ma vie s'enfuient dans les ruelles de la ville, je me tourne vers la clôture, où la fumée des gaz lacrymogènes, éclairée par les puissants projecteurs des 4×4 de la police, fait ressembler à la porte de l'enfer la brèche que nous avions réussi à ouvrir dans la clôture. En chemin, je croise plusieurs survivants. Certains courent seuls, d'autres par deux ou en petits groupes. Certains pleurent de peur, d'autres se plaignent d'un coup, mais tous leurs visages trahissent la joie d'avoir réussi à sauver leur vie.
Oscar, un des gars qui a aidé à construire l'escalier, s'approche de moi, fou de joie.
-Merci à papa, merci à mon papa ! -Elle sanglote, en envoyant des baisers au ciel.
Félicitations, mon fils", lui ai-je répondu en le serrant dans mes bras. Je suis sûr que ton père serait très fier de toi. C'était un grand homme et il a donné sa vie pour que tu puisses être en sécurité ici aujourd'hui.
-Les gardes ont mis du temps à arriver, et à ce moment-là, presque tout le monde avait déjà sauté. Ils ont donné beaucoup de bois de chauffage, des femmes, des enfants... Puis ils ont sorti leurs fusils et ont commencé à tirer sur ceux qui essayaient encore de sauter, qui sont tombés morts dans les escaliers ou alors qu'ils couraient ici. C'était horrible. Ils n'ont aucune pitié, ces fils de pute.
-Bien sûr, Oscar, il n'y a pas de loi de l'autre côté et personne ne s'inquiétera pour nous. Courage, continue de courir, tu y es presque.
Merci patron, soyez prudent", me souhaite-t-il en courant vers la ville.
Un peu plus loin, une femme d'une quarantaine d'années est aidée à marcher par ses deux enfants adolescents, un de chaque côté. Elle traîne un de ses pieds. On voit qu'elle s'est déboîté la cheville, mais elle est aussi rayonnante de bonheur.
-Ne continuez pas, patron, il n'y a plus personne", me dit un des garçons. Nous sommes les derniers parce que nous avons dû l'aider. En plus, nous devons nous mettre à l'abri parce qu'il semble qu'il va bientôt pleuvoir.
Le garçon a raison, mais au dernier regard vers la clôture, je crois voir la silhouette d'un homme se détachant sur le nuage lumineux du champ de bataille. Il ne pouvait pas être mort, car il était agenouillé, alors je décide de m'approcher, mais pas avant de leur dire où emmener sa mère pour la soigner.
Alors qu'ils s'éloignaient, je me suis tourné vers la silhouette qui s'avérait être Obama. Le regard perdu dans l'infini, il répétait en boucle des mots que, en m'approchant, j'ai reconnu comme des Ave Maria.
-Obama, viens, ne reste pas ici. Je lui demande des nouvelles de sa femme et de ses deux enfants car, en le voyant seul, je comprends que rien de bon ne leur est arrivé.
-Ils sont partis, ils ont été criblés comme des lapins, je n'ai nulle part où aller, je ne veux aller nulle part. Laissez-moi mourir en paix ! -Il gémit.
-Après avoir fait tout ce chemin, je t'interdis de mourir, Obama ! Allez, lève-toi, la ville n'est plus qu'à quelques mètres.
-Je ne suis pas Obama, mon nom est José Luis ! Obama et sa famille seront tellement à l'aise dans leur bunker à comploter pour dominer la planète que ses amis ont fait exploser.
-Allez, José Luis, tu vas encore t'inquiéter des conspirations ? Ta femme et tes enfants seront heureux d'apprendre que tu as réussi à survivre et que tu es arrivé sur cette terre africaine bénie. Il ne reste rien de l'Europe. Les villes qui n'ont pas été anéanties par les bombes nucléaires sont contaminées, mais tu as réussi à arriver jusqu'ici ! Ne vois-tu pas que c'est un miracle ?
-Et dire que c'était eux, les Africains, qui grimpaient jusqu'à Europe Qu'est-ce qu'ils s'attendaient à trouver à l'Ouest, la civilisation ? Civilisation ? Animaux ! -C'est ce qu'ils avaient dans notre pays ! Purement et simplement, des animaux ! Meurtriers !
Voyant l'état de choc de mon compagnon d'évasion, j'essaie de le relever et de le forcer à se diriger vers la ville. Je passe mon épaule sous son bras et, alors que j'essaie d'enrouler la mienne autour de sa taille, je sens ma chemise chaude et humide. Je regarde ma main et réalise immédiatement.
-Tu es blessé, José Luis. Nous devons courir au poste de secours pour arrêter l'hémorragie.
-Laisse-moi mourir ici. Je suis sérieuse, Ricardo", me demande-t-elle en larmes.
Le fait que mon prénom soit connu est un mélange de fierté et de tristesse. Depuis que nous avons fui l'Espagne sur ce ferry-boat que nous avons réussi à détourner vers l'Afrique, tout le monde s'adressait à moi en m'appelant "le patron". Le fait qu'il m'ait appelé par mon nom montrait son intérêt pour ce que j'étais. Ou plutôt qui j'avais été. Entendre "Ricardo" m'a rappelé l'époque où je travaillais de huit heures à trois heures, où mes soucis se résumaient à la cherté des fruits, de l'essence ou de l'électricité, où j'avais un pays, une maison, une grande famille, des centaines d'amis, de collègues et de connaissances. Mais l'attaque nucléaire a tout balayé en un seul jour. Les anciens pays "civilisés" n'étaient plus qu'un désert infectieux, où aucun être humain ne pouvait survivre pendant des siècles.
-Allez, mon pote ! -Je l'encourage. Il va commencer à pleuvoir et nous devons nous protéger des radiations que l'eau va transporter avec elle.
-Je ne me soucie plus des niveaux de radioactivité. J'ai tout perdu. Je veux juste mourir en paix", dit-il avant de s'éteindre.
Je le porte sur mon dos et réussis à l'amener au poste de secours où, peu après, on me confirme qu'il s'agissait d'une simple syncope. La balle était entrée et sortie proprement, sans toucher aucun organe important. Ils me donnent ses affaires personnelles - un portefeuille et un sac en plastique contenant plusieurs passeports - que je garderai pour lui pendant sa convalescence. Je suis impressionné par l'accueil du personnel médical et des volontaires du camp de réfugiés. Tous des locaux. Pas un mot de reproche : seulement de l'affection et du réconfort. Nous avons envahi leur pays, ceux-là mêmes qui, il y a peu, les empêchaient de passer la frontière en sens inverse. Du sud au nord, du nord au sud, quel est le sens de la vie maintenant ?
La pluie claque sur la bâche de la tente du camp de réfugiés où je rejoins ma femme et ma fille. Certaines familles, assises sur les lits, parlent du sort de tel ou tel ami. D'autres discutent des différents itinéraires possibles pour la prochaine étape du voyage vers le sud, à la recherche de zones plus sûres et radioactivement propres. Je reste au centre, près de la cuisinière qui chauffe la pièce et fait bouillir l'eau pour le thé. À la lumière des braises, j'ouvre le portefeuille de José Luis et je vois que, parmi ses papiers, il y a une carte de membre d'un parti politique. Malgré le moment dramatique que nous venons de vivre, je ne peux m'empêcher d'éclater de rire, ce qui fait soudain taire les conversations de tous les réfugiés de la tente.
-Patron, ça va ? Pourquoi tu ris ? -se lamente Montse, une Catalane qui a réussi à atteindre la côte africaine toute seule, sans savoir naviguer, sur son petit voilier.
-Oui, Montse, ne t'inquiète pas", réponds-je en jetant la carte d'identité dans le feu sans pouvoir m'empêcher de rire encore plus fort.
En regardant le plastique du document fondre, les rires hystériques font place aux larmes, et je peux enfin libérer toute la tension accumulée. Serrant mes proches dans mes bras, je pleure amèrement pour le jour où la humanité il a perdu ses sens.
Journaliste. Diplômé en sciences de la communication et licencié en sciences religieuses. Il travaille dans la délégation diocésaine des médias à Malaga. Ses nombreux "fils" sur Twitter sur la foi et la vie quotidienne sont très populaires.