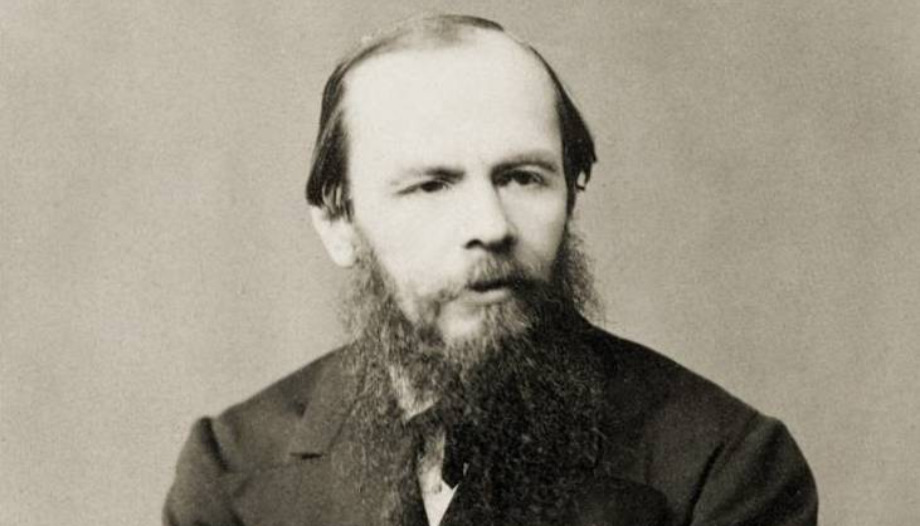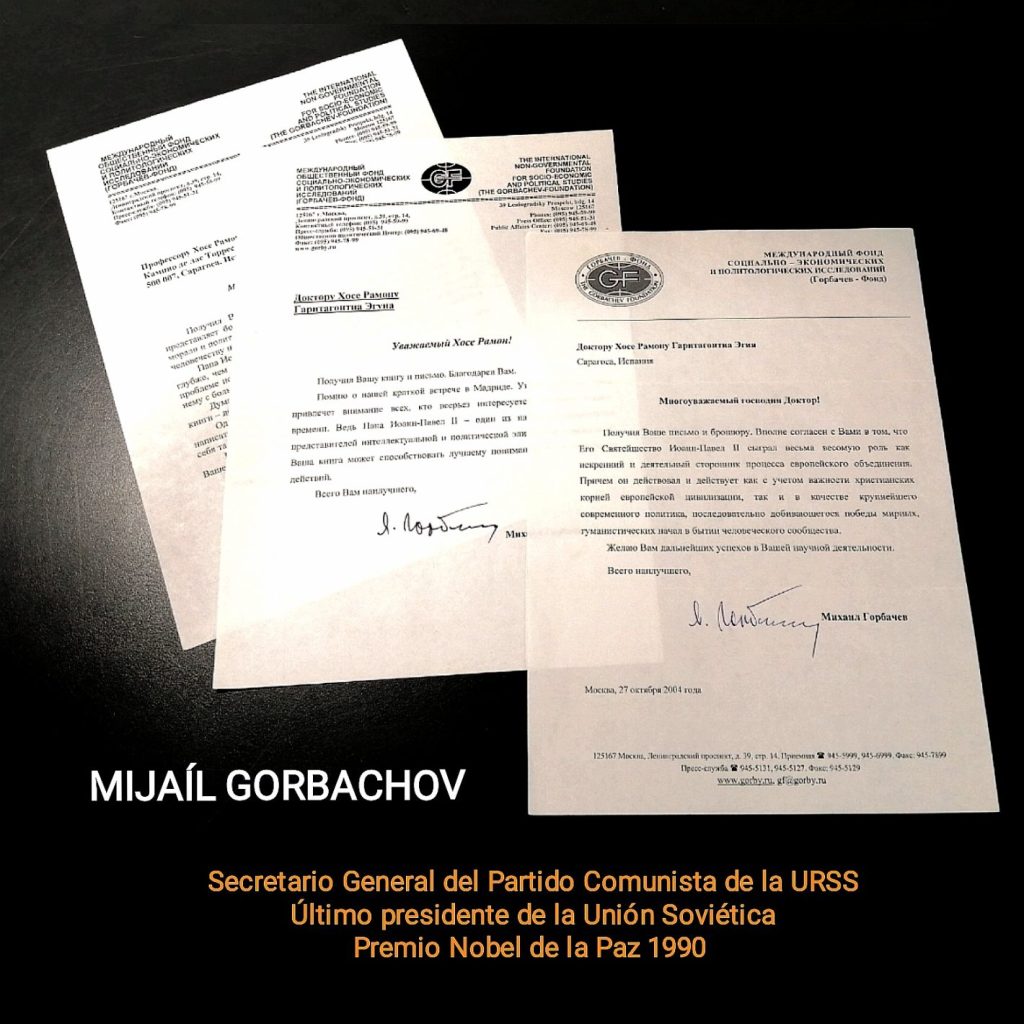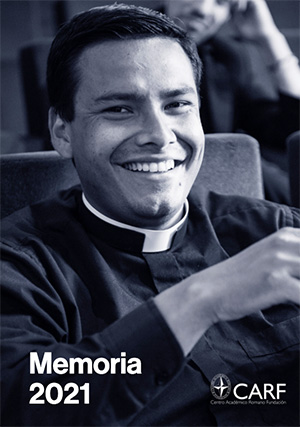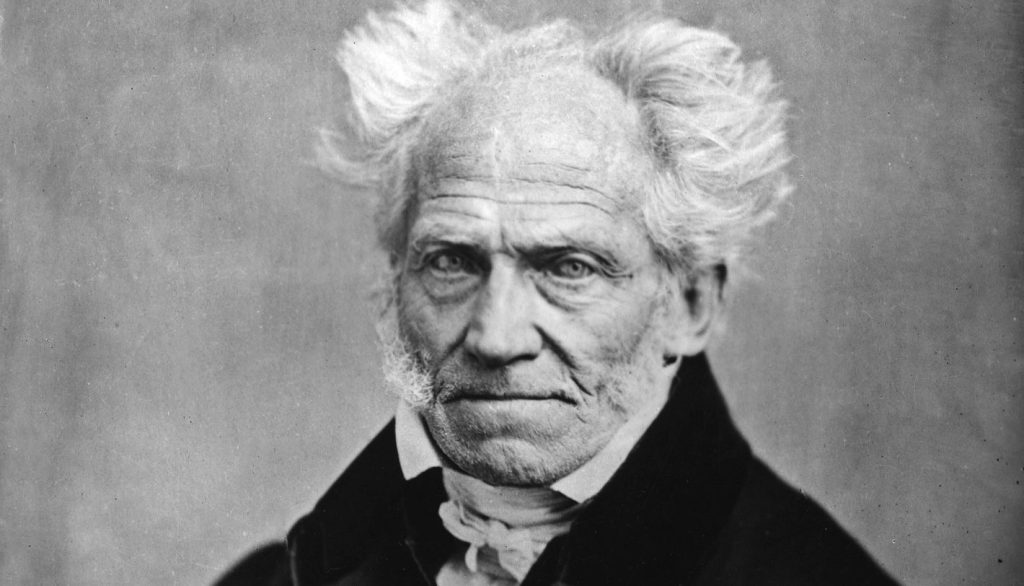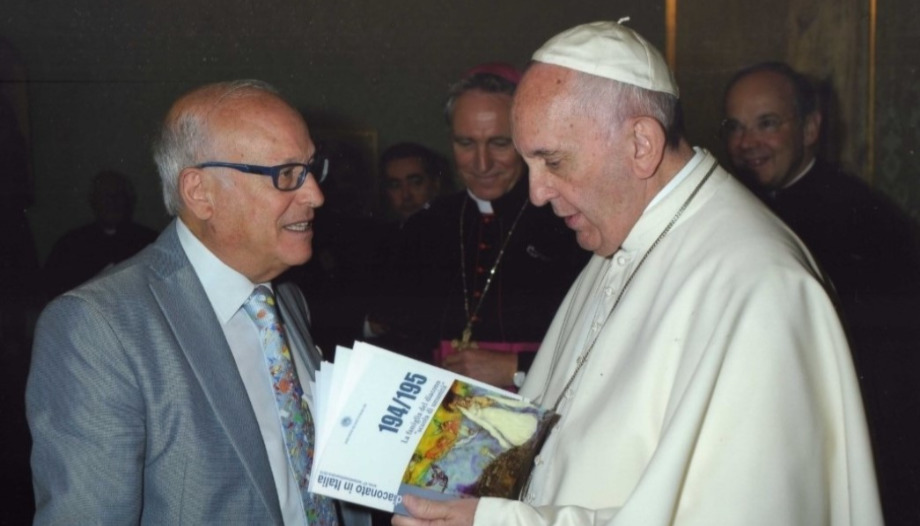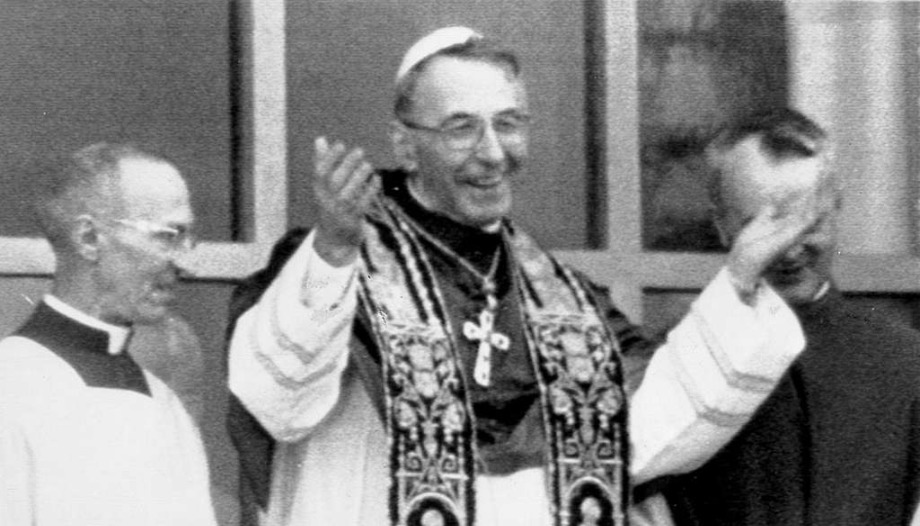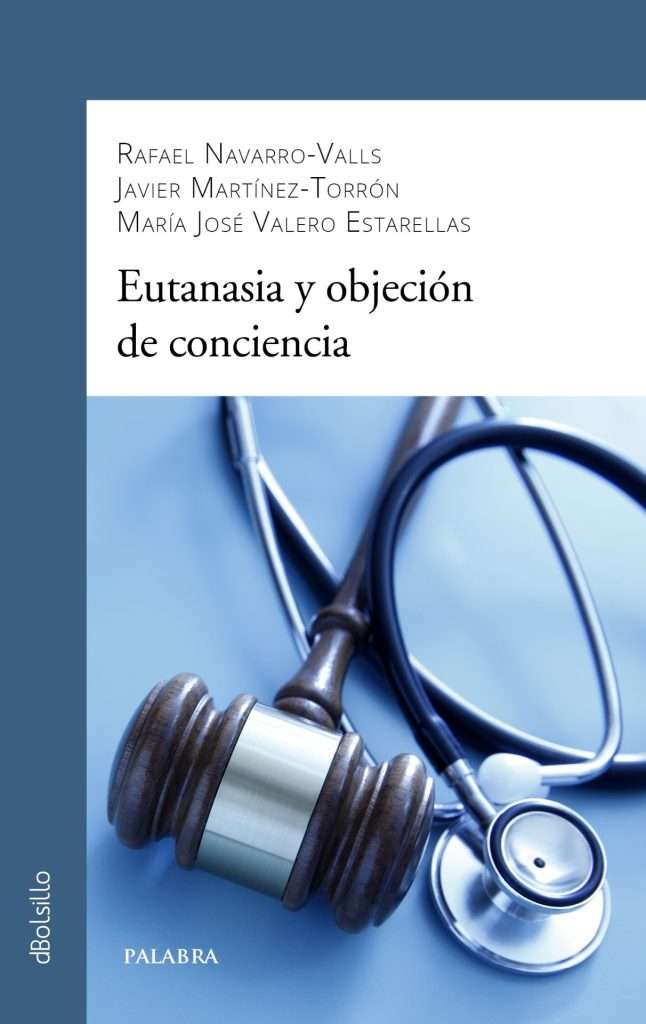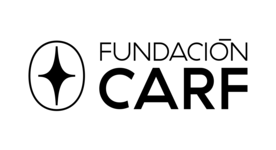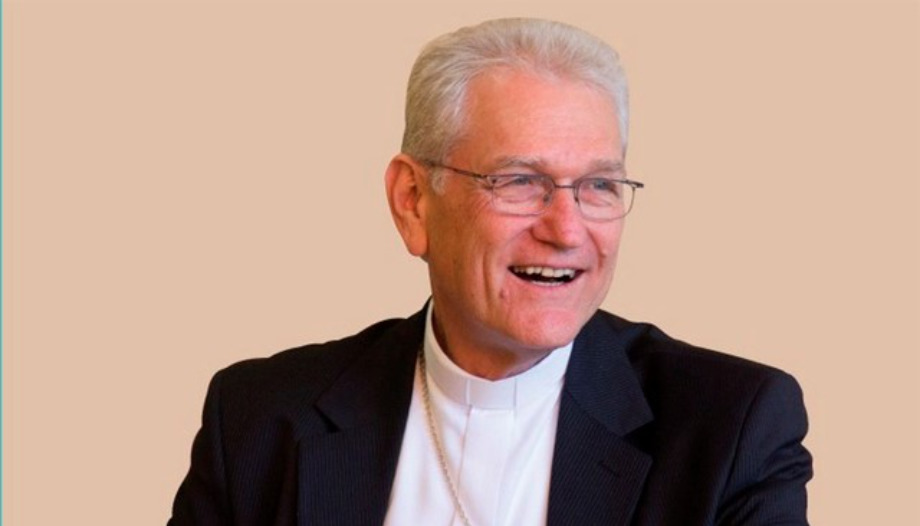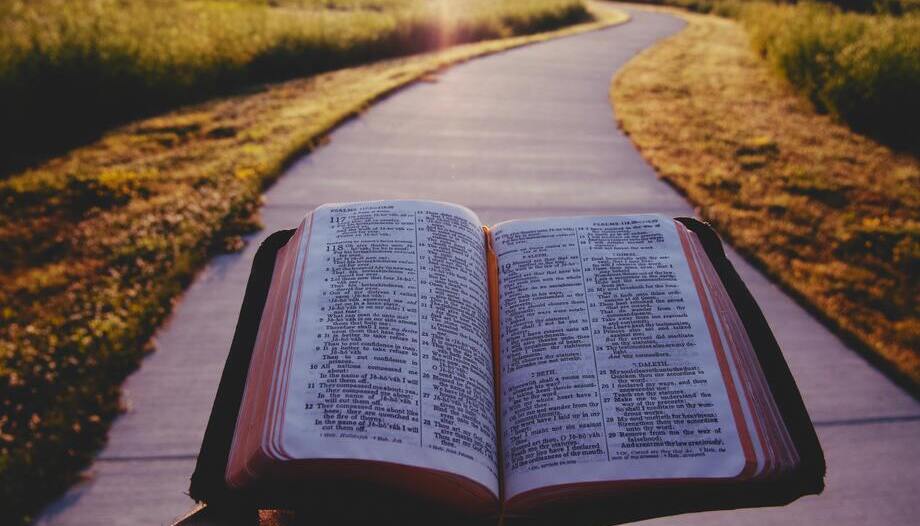"Si vous voulez réussir au travail, vous devez d'abord vous gérer vous-même. Cela nécessite une excellence intérieure ou une spiritualité". Et cela inclut une vie sereine, avec moins de stress.
Nous sommes d'accord, mais nous nous demandons : qui l'a dit ? Qu'est-ce que c'est et comment atteindre cette excellence intérieure dans le travail quotidien étouffant ? Comment le rendre compatible avec une famille : des enfants en bas âge et des parents qui ont aussi besoin de soins ? Avec les aspirations professionnelles et les désirs de changer le monde ? Avec le manque de temps, la compétitivité de l'environnement et les nombreux engagements ?
Sans trop réfléchir, parce que nous n'avons pas le temps, nous voulons laisser l'autogestion théorique et la spiritualité à ceux qui se séparent du monde. Ce que nous voulons, c'est résoudre l'immédiat, le succès, l'influence, le pouvoir, l'argent, les biens concrets... Mais nous aspirons aussi au repos, à la paix, à la sérénité et à la détente.
Le monde des affaires a prouvé qu'il est non seulement possible de combiner une vie sereine et détendue avec le succès et les bonnes affaires, mais que c'est le meilleur moyen d'y parvenir. Les plus grandes entreprises proposent des espaces de détente pour leurs employés, des cours de yoga, des activités de pleine conscience et autres.
pour réduire le stress. Tout cela conduit à une meilleure santé individuelle, familiale et sociétale.
Des formes traditionnelles de repos à la méditation
Il existe de nombreuses formes de repos et de relaxation. Lire un livre non seulement intéressant mais aussi divertissant, réfléchir calmement à ce que l'on a lu..., se promener en contemplant la nature, apprécier des œuvres d'art, un morceau de musique ou une peinture, le tourisme qui vous ouvre à des cultures différentes. Et bien sûr, le dévouement à la famille, la conversation avec les amis, qui permet de profiter plus facilement des week-ends pour oxygéner l'esprit et le corps.
Les effets bénéfiques du sport et de l'exercice sont bien connus, surtout lorsqu'ils sont pratiqués dans le calme. Moins à la mode aujourd'hui, les méthodes de relaxation plus ardentes, telles que les sports fatigants et intenses en courtes demi-journées, qui étaient autrefois l'idéal de tout "yuppie" (acronyme de jeune professionnel urbain).
Étirer les muscles et les mobiliser en douceur à tout âge est sain, prévient le risque de blessure, réduit les douleurs articulaires et aide à retrouver énergie, agilité et force. Il réduit le stress et l'anxiété, améliore l'humeur, la qualité du sommeil et la réponse immunitaire.
Parfois, l'exercice prend des formes élégantes ou poétiques du corps. Par exemple, dans le tai chi, adapté des arts martiaux chinois, que l'on peut voir dans les parcs du monde entier, de Tokyo à Rome : des groupes de personnes, en chœur ou isolées, déploient avec souplesse des mouvements coordonnés en parfaite synchronisation. Même les personnes très âgées constatent les bienfaits de ces pratiques, avec une meilleure qualité de vie et même une réduction du risque de chutes et de fractures.
Ces faits nous rappellent que nous sommes corps et âme, matière et esprit. De nombreuses pratiques, anciennes et récentes, tiennent compte de cette réalité et tentent de satisfaire les besoins matériels et spirituels. Les formes les plus courantes sont les méditations, qui combinent l'introspection avec des mouvements corporels et le rythme de la respiration.
La méditation classique consistait à réfléchir au sens de la vie, à entrer en relation avec le sacré et peut-être à s'adresser à un créateur ou à une divinité. Aujourd'hui, elle est pratiquée par de nombreuses personnes pour réduire le stress quotidien, en recherchant la paix et le calme intérieurs et extérieurs dans un échange fluide. Le sacré est souvent oublié. En pratique, il s'agit de se concentrer sur un point serein de l'esprit et du corps, et que cette attention annule en quelque sorte les pensées tourmentées.
Cette pause dans les processus mentaux, avec ou sans le sacré, agit comme une "réinitialisation" émotionnelle. Après quelques moments de détente physique et mentale, il est possible de voir ce qui était auparavant stressant sous un jour nouveau. Les façons de gérer le stress changent et l'imagination et la créativité augmentent. Le site
En un sens, le mental réinitialisé fait place à un "flow", ou flux positif et lumineux, qui améliore la patience et la tolérance.
Des pratiques diverses... et leur multiplication
De nombreux types de pratiques incluent ou sont un type de méditation. L'état de paix réfléchie peut être favorisé par des images visuelles, des sons répétitifs, des odeurs, des textures, l'application d'huiles sur la peau en Ayurveda, la récitation d'un mantra ou d'un mot qui occupe l'esprit et chasse les autres pensées, la méditation transcendantale qui vise la relaxation du corps, la pleine conscience, le yoga...
Chaque style de méditation nécessite un entraînement pour focaliser l'attention et aider à libérer l'esprit des émotions négatives : peur, honte, colère, tristesse, tension. Toutes les formes mettent l'accent sur une respiration détendue, profonde et régulière, en utilisant le diaphragme pour obtenir une plus grande expansion des poumons.
Elles se font généralement dans une position et une posture confortables qui n'interfèrent pas avec le flux des pensées, et dans un endroit calme avec peu de distractions, y compris les téléphones portables. Mais il est possible de se concentrer et d'expirer calmement en marchant, dans la salle d'attente du dentiste, ou avant un examen ou un discours en public. Lorsque la technique est apprise, les avantages physiologiques sont clairs : la respiration diaphragmatique, ainsi que divers exercices de relaxation musculaire profonde, abaisse le rythme cardiaque et la pression sanguine.
Depuis les années 1980, les pratiques de méditation se sont multipliées et sont entrées dans les routines des écoles et des entreprises, des clubs sportifs et des protocoles médicaux.
Le célèbre livre d'auto-assistance de Stephen Covey "The Self-Help Book of Stephen Covey".Les sept habitudes des personnes très efficaces"(1989) attache une grande importance à la septième habitude, "affûter la scie". Celui qui coupe des arbres, dira-t-il avec un exemple imagé, doit s'arrêter de temps en temps pour réparer son outil, sinon il ralentira son travail, jusqu'à détruire complètement l'outil.
Ceux qui travaillent et veulent obtenir de bons résultats doivent apprendre à se reposer, à se détendre, à prendre soin de leur santé spirituelle et physique - le corps étant un instrument - à prendre le temps d'apprendre, d'être avec les autres, de méditer.
Dans les milieux religieux, où la recherche du sacré ne doit pas être négligée, on constate également un intérêt croissant pour les formes orientales de méditation. On peut trouver des annonces pour des cours spécialisés dans les publicités des universités, dans le foyer d'un hôpital, dans un bus ou dans des lieux de culte.
Nous nous pencherons sur les deux formes de méditation les plus populaires en Occident, le yoga et le yoga. pleine conscienceLa prière ou la méditation chrétienne est ensuite commentée.
Le yoga avec son silence et son abandon
Yoga est un mot sanskrit. Il existe des traces de son utilisation depuis environ 3000 ans avant Jésus-Christ. La base religieuse est l'hindouisme et correspond à l'une de ses six doctrines. Comme d'autres formes de méditation, elle est présentée comme une méthode permettant d'atteindre l'équilibre et de mettre la souffrance de côté. Il a également un but moral, le "karma yoga", qui est la réalisation de soi.
Selon la doctrine du yoga, l'être humain est une âme enfermée dans un corps, qui comporte quatre parties : le corps physique, l'esprit, l'intelligence et le faux ego. Dans la religion hindoue, le yoga est une voie spirituelle permettant d'expérimenter le contact avec le divin : l'intégration de l'âme individuelle à Dieu (c'est-à-dire au "brahman") ou à sa divinité (qui est l'"avatar") et la libération de l'esclavage matériel.
Le yoga présente les huit étapes d'une réalisation de soi qui repose sur trois bases : la suppression des modifications du mental, avec le silence ; le non-attachement, ou non-ego ou nullité ; l'abandon pour atteindre le "samadhi", qui est la pleine réalisation de soi, l'éveil intérieur, la force spirituelle et la communication avec le divin.
En tant que forme de méditation, il utilise diverses postures (appelées "asana yoga") pour agir sur le corps et l'esprit. Il y aurait une résonance spéciale de différents points d'énergie de l'organisme le long de la colonne vertébrale. Dans les magasins de sport du monde entier, des centaines de produits de toutes les couleurs sont disponibles pour le yoga. Le plus important est d'avoir un tapis et un coussin, qui sont appelés "sabuton" et "zufu".
Les clés de la pratique du yoga sont : la lenteur des mouvements, la respiration lente, consciente et dirigée, et l'attention mentale dans un état de réceptivité à ce qui se passe. Les postures peuvent être accompagnées de la répétition d'un mantra, pour se concentrer sur l'inspiration et l'expiration régulières et lentes.
Ses promoteurs affirment qu'il a de nombreux effets positifs sur le corps, notamment une réduction du stress et une augmentation de la concentration et de la clarté mentale. Dans le corps, par exemple, les exercices de yoga améliorent la souplesse, la coordination et l'endurance.
De nombreuses personnes pratiquent le yoga pour ses bienfaits psychophysiques, avec un rejet ou une indifférence à l'égard du contexte religieux. Dans les écoles d'enfants indiennes, c'est une discipline obligatoire. Il y a aussi ceux qui se tournent vers le yoga comme une passerelle vers d'autres expériences religieuses de l'Orient, et il n'est souvent pas facile de se détacher du cadre doctrinal qui le sous-tend.
De la sati bouddhiste à la pleine conscience
La pleine conscience est un phénomène plus récent, qui emprunte au yoga des postures de méditation. Il s'agit de la traduction anglaise moderne du terme bouddhiste "sati", qui est considéré comme un type de méditation.
La pleine conscience est décrite dans le recueil d'écrits bouddhistes, compilé avec des commentaires au 5ème siècle, dans le "Digha nikaya" (DN 22). Elle y est énoncée comme une prière : "La voie à but unique, ô moines, provient des quatre piliers pour atteindre la purification, pour surmonter les pleurs et les lamentations, pour se détourner de la douleur et de la souffrance : l'observation du corps, l'observation des sensations, l'observation de l'esprit, l'observation des éléments". Le Digha nikaya décrit également la manière de pratiquer la méditation de pleine conscience : jambes croisées et attentif, se concentrer sur l'inspiration et l'expiration, faire l'expérience du corps.
Selon les promoteurs de la pleine conscience, sa pratique augmente la concentration mentale (la "samatha" ou méditation, qui obtient la tranquillité en se concentrant sur la respiration ou en récitant un mantra) ; elle aiguise également la vision intérieure (la "vipassana" ou méditation subordonnée à la "sati") : pour cela, il faut se concentrer ou se fixer sur la même concentration.
Les principaux diffuseurs de la pleine conscience en Occident sont le moine bouddhiste vietnamien Thích Nhât Hanh (né en 1926) et son disciple américain de tradition hébraïque, le biologiste John Kabat-Zinn (né en 1944). Elle était présentée comme l'essence du bouddhisme.
Thích Nhât Hanh donne un exemple de ce que pourrait être la pleine conscience : "Lorsque vous faites la vaisselle, faire la vaisselle devrait être la chose la plus importante de votre vie, que vous soyez en train de boire du thé ou dans la salle de bains...". Il ajoute : "Vivre le moment présent, c'est le miracle.
Une question qui exprime ce que pourrait être cette pleine conscience serait : votre corps est présent, et votre esprit est là aussi ? La définition de la pleine conscience a été étendue comme une attention totale dans le moment présent, une "attention particulière au présent, avec une attitude d'acceptation".
L'accent est mis sur la concentration sur sa propre respiration et ses pensées, sans jugement et sans réflexion. Sati", disent-ils, ne cherche pas à éliminer les pensées ou les sentiments, mais à ne pas s'identifier à eux. Il s'agit de les considérer de manière impersonnelle, afin de ne pas les laisser nous entraîner vers le bas.
Les promoteurs affirment qu'il s'agit d'un état d'esprit que tout le monde peut atteindre, comme la concentration, la pleine conscience et l'attention. La concentration sur le corps, les pensées et les sentiments permet de voir la vraie nature de la haine, de l'avidité, de la souffrance et du ressentiment, de s'en éloigner et d'atteindre le nirvana. Par la concentration, diront-ils, on fait le vide en soi et la souffrance disparaît : "sati" s'éloigne du faux moi ("anatta") et atteint le sommet de l'éthique bouddhiste qui est la compassion ("karuna"), en se détachant de l'égoïsme, en s'unissant à l'univers et en prenant soin de l'universalité avec amour.
La pleine conscience a des manifestations culturelles, comme la cérémonie du thé au Japon, dans laquelle on apprécie le moment social de la rencontre avec l'autre, unique et non répétable, en partageant une boisson et un espace de détente dans sa propre maison.
Développer la pleine conscience
En Occident, elle a été mise en avant comme une compétence sans connotation religieuse. Elle a été introduite en médecine en tant que technique de réduction du stress basée sur la pleine conscience : Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR). Il est utilisé pour la dépression, l'anxiété, les troubles obsessionnels compulsifs et d'autres pathologies. Comme pour d'autres formes de méditation appliquées à la médecine, des effets indésirables ont été décrits, dus à une concentration excessive sur ses propres pensées. L'hyper-réflexion peut accentuer certains troubles mentaux.
La pleine conscience est proposée aux enfants et aux adultes. Elle est utilisée dans les addictions, pour de meilleures performances sexuelles, la grossesse et le pré-partum, le burnout, les affaires et la vie quotidienne... Il existe des applications numériques qui font bouger des millions de personnes, associées à des universités et des entreprises, comme Harvard et
Google, pour n'en citer que quelques-uns.
Il est devenu un produit de consommation qui est parfois présenté comme infaillible pour apporter la paix. C'est pourquoi certaines personnes l'appellent ironiquement "McMindfulness". Comme le yoga, il n'est pas toujours facile de le détacher de son arrière-plan religieux.
La plupart des académies de yoga et de pleine conscience insistent sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une religion, mais d'une discipline qui tente d'allier harmonie de l'esprit et du corps et relaxation. Cependant, dans de nombreux livres et dans les salles de sport, des concepts issus de l'hindouisme ou du bouddhisme sont expliqués. Parfois, ces perspectives considèrent la croix du Christ comme un simple masochisme.
L'augmentation des pratiques de méditation, plus ou moins liées à des concepts religieux, manifeste une soif de spiritualité. Ils peuvent contribuer à la dispersion des remèdes, ils donnent de l'importance et de l'espace au corps et à ses
les énergies, et aident à contrôler et à développer le moi intérieur.
Comment la prière chrétienne se positionne-t-elle face à la demande de paix et de plénitude, de spiritualité ?
La prière chrétienne comme forme de méditation
La prière, présente dans de nombreuses religions, est la méthode de méditation la plus courante. Ses bienfaits pour la santé ont été prouvés par de nombreux essais cliniques. Les formes sont variées, allant de la répétition de mots, parfois sous forme de mantra, à l'union silencieuse ou au dialogue avec un être supérieur.
La prière chrétienne affirme que l'on s'adresse à un Dieu personnel, qui écoute et aime l'être humain. Bien que moins présent que dans d'autres religions, le symbolisme psycho-physique du corps n'est pas exclu, et il est bien sûr conseillé de prier avec sérénité et détente. "La prière concerne toute la personne" : elle est
prie avec tout son être, ce qui inclut le corps et le cœur ou le monde affectif.
D'une certaine manière, la méditation, même sans recours au sacré, permet de se sentir non pas le centre de l'univers, mais une partie de celui-ci, ce qui contrecarre la tendance égocentrique de l'être humain. Les enseignements chrétiens apportent plus de clarté à cet aspect. Le but n'est pas de s'observer ou d'atteindre l'équilibre seul, mais d'aimer les autres, ce qui implique un effort et une certaine tension.
Se tourner vers Dieu, sentir sa présence dans le silence du cœur, nous stimule à sortir de nous-mêmes. Découvrir qu'il existe un Dieu qui nous voit, nous entend et nous aime est un bon moyen de concentrer sa conscience sur ce qui est important. Cela peut se faire par des moments de paix dans chaque pratique de piété, en particulier dans les moments suivants
la prière, qui imprègne la pensée et l'action.
C'est un bon moyen de réduire les inquiétudes et les pensées négatives sur soi-même et sur les autres, et de découvrir un nouveau sens à la vie. Peu à peu, celui qui prie arrive à intérioriser le Christ, dans une "relation intime d'amitié", dans une prière de recueillement et de paix, comme l'écrivait sainte Thérèse.
Jésus était l'un de nous, avec nos affections, nos actions, nos désirs et nos pensées. Il s'agit d'observer et d'imiter son regard, son visage et son cœur ; et tout cela avec l'aide directe de Dieu lui-même : l'Esprit Saint, qui éclaire et donne le repos à ceux qui se tournent vers lui.
La prière chrétienne, qui, loin de négliger le sacré, est un dialogue avec Dieu, est source d'optimisme et réduit le stress de manière plus profonde et plus permanente que la relaxation méditative des fondements orientaux. On laisse tomber le passé, en se rendant compte de ses erreurs. Elle fait face au présent, s'efforçant de s'améliorer, et elle regarde l'avenir avec espoir, souhaitant un monde meilleur pour tous.
En invitant "le soleil, la lune et les plus petits animaux" à chanter, on apprend à partager la terre avec des hommes et des femmes de tous horizons, avec des poissons, des oiseaux, des plantes..., on renonce à "faire de la réalité un simple objet d'utilisation et de domination" ; et on reconnaît "la nature comme une splendide
livre", comme l'a écrit le pape François dans Laudato si'.
De nombreux saints mettent l'accent sur la prière associée à la paix. Je termine par un texte de saint Basile, qui résume bien la pleine conscience, la méditation ou la pleine conscience du chrétien : " C'est la belle prière qui rend Dieu plus présent dans l'âme [...]. C'est en cela que consiste la présence de Dieu : avoir Dieu en soi.
d'elle-même, renforcée par la mémoire [...].
Nous devenons un temple de Dieu : quand la continuité de la mémoire n'est pas interrompue par les préoccupations terrestres, quand l'esprit n'est pas troublé par des sentiments fugaces, quand celui qui aime le Seigneur se détache de tout et se réfugie en Dieu seul, quand il rejette tout ce qui incite au mal et passe sa vie dans l'accomplissement d'actes vertueux".
La contemplation de la croix et de la résurrection du Christ, de sa très sainte humanité qui, remplie d'amour pour le Père, a de la compassion pour tous au point de donner sa vie pour nous, nous introduit dans le mystère de l'amour de Dieu. Cette contemplation aide à enraciner notre filiation divine dans les profondeurs de notre esprit, sous la conduite de l'Esprit Saint, et nous conduit à crier "Père !" dans toutes les circonstances de la vie : face au bon et au mauvais, face à ce que signifie sortir de soi et se donner aux autres de manière sacrificielle.
La paix intérieure est propre à ceux qui se savent vraiment enfants de Dieu, et cette vérité est renforcée et vécue si, dociles à l'Esprit Saint, nous sommes des femmes et des hommes de prière, des contemplatifs au milieu de notre existence.
La prière et nos actions calmes génèrent des sentiments de paix et de bien-être. Quelle est l'utilité du conseil de se gérer soi-même et de soigner l'excellence intérieure ou la spiritualité, cité au début. Elle émane de l'un des plus grands entrepreneurs de l'Inde, Grandhi M.R., né dans un petit village pauvre.
de l'Andhra Pradesh.
Différences entre les différentes pratiques
Reposez-vous
Détente traditionnelle : lecture, marche, nature, visites touristiques...
➔ Autres pratiques :
- Ne reléguez pas la recherche du sacré.
- Techniques basées sur la respiration détendue.
Yoga
Base religieuse de l'hindouisme. L'être humain comme une âme enfermée dans un corps.
➔ Wanted :
- Atteindre l'équilibre et se défaire des attachements matériels.
- Finalité morale : réalisation de soi.
Techniques : postures, pleine conscience, respiration, répétition de mantras.
Il n'est pas facile de la détacher de son contexte religieux et doctrinal.
La pleine conscience
➔ Base religieuse dans le bouddhisme.
➔ Wanted :
- Soyez attentif au moment présent.
- Considérez les pensées et les sensations de manière impersonnelle, sans vous identifier à elles.
- Atteindre le nirvana et rejoindre l'univers.
Outil médical, mais aussi produit de consommation.
Elle peut rester liée à des aspects de l'hindouisme ou du bouddhisme.
Prière chrétienne
Nous nous adressons à un Dieu personnel, qui écoute et aime les êtres humains.
Elle concerne l'ensemble de la personne, y compris le corps et le monde affectif.
➔ Stimule à sortir de soi :
- Cela permet de concentrer la conscience sur ce qui est important.
- Elle conduit à une relation d'amitié avec Dieu et à l'amour des autres.
C'est une source d'optimisme. Elle réduit le stress d'une manière plus profonde que la relaxation méditative fondée sur des bases orientales.
L'auteurFiole WenceslasDocteur et prêtre.
 Que se passe-t-il au Chili ? Au seuil d'un référendum constitutif
Que se passe-t-il au Chili ? Au seuil d'un référendum constitutif Chili : "Il est nécessaire de promouvoir les valeurs chrétiennes dans la nouvelle Charte fondamentale".
Chili : "Il est nécessaire de promouvoir les valeurs chrétiennes dans la nouvelle Charte fondamentale". Chili : un triomphe pour la liberté religieuse
Chili : un triomphe pour la liberté religieuse