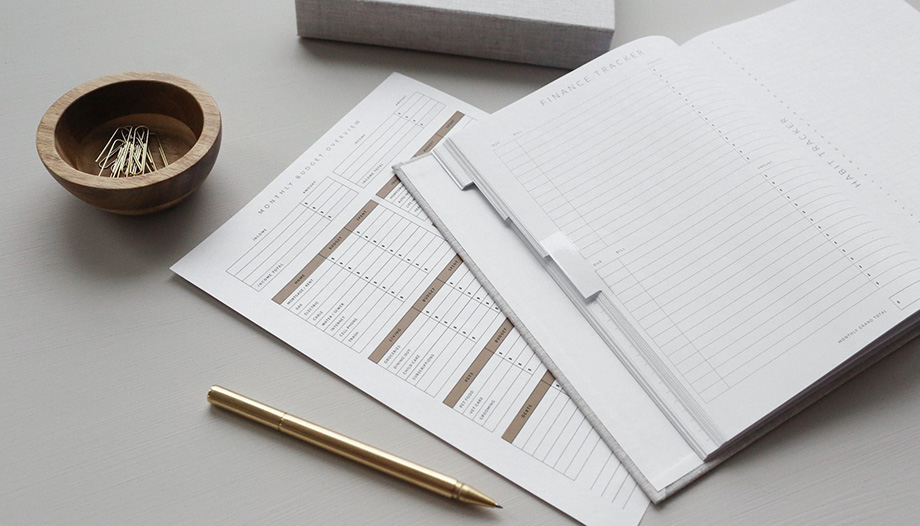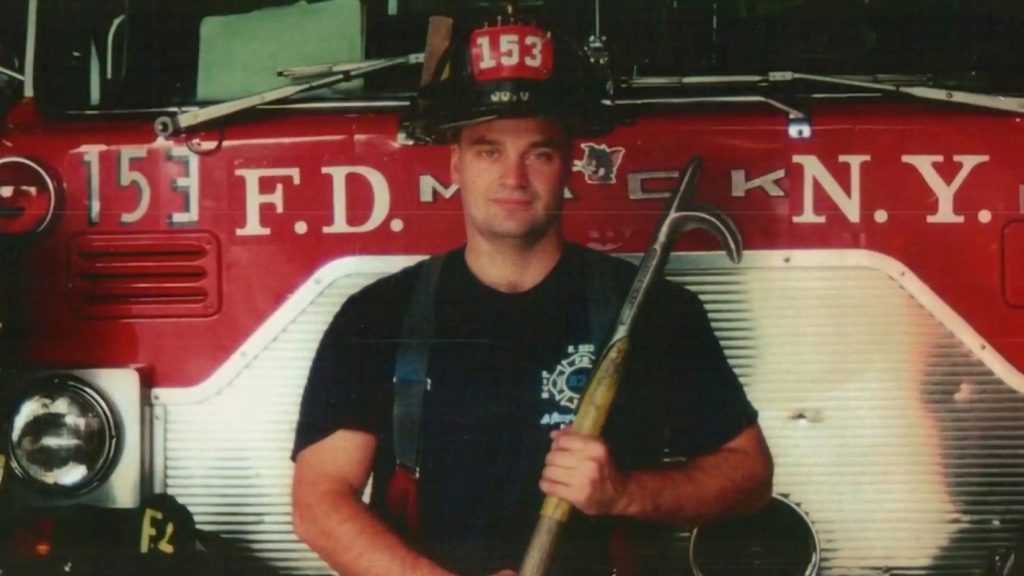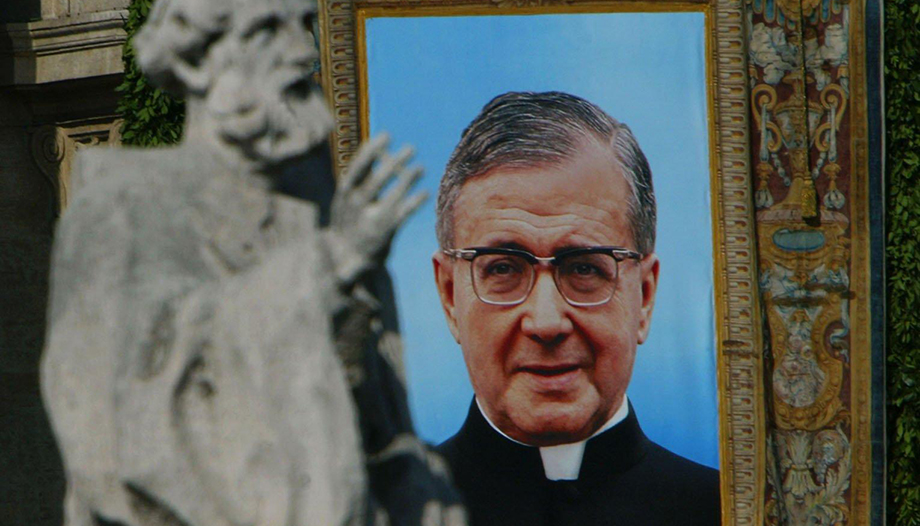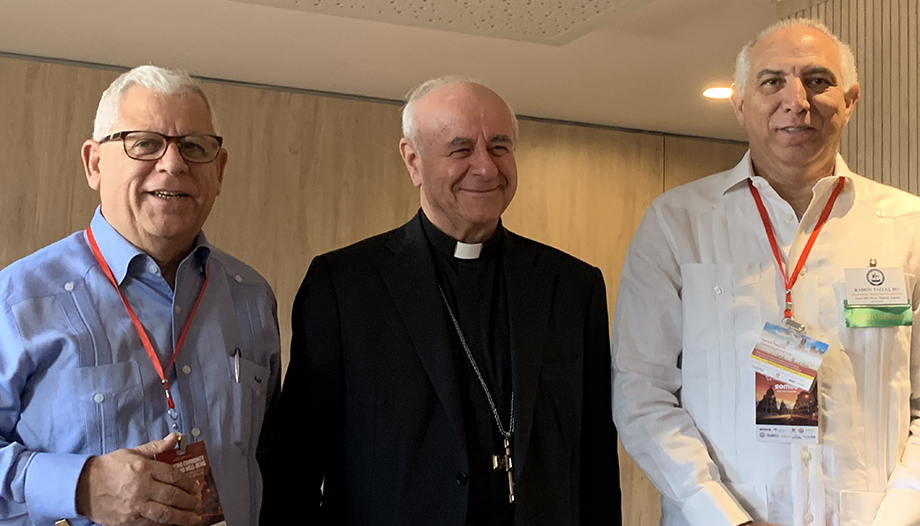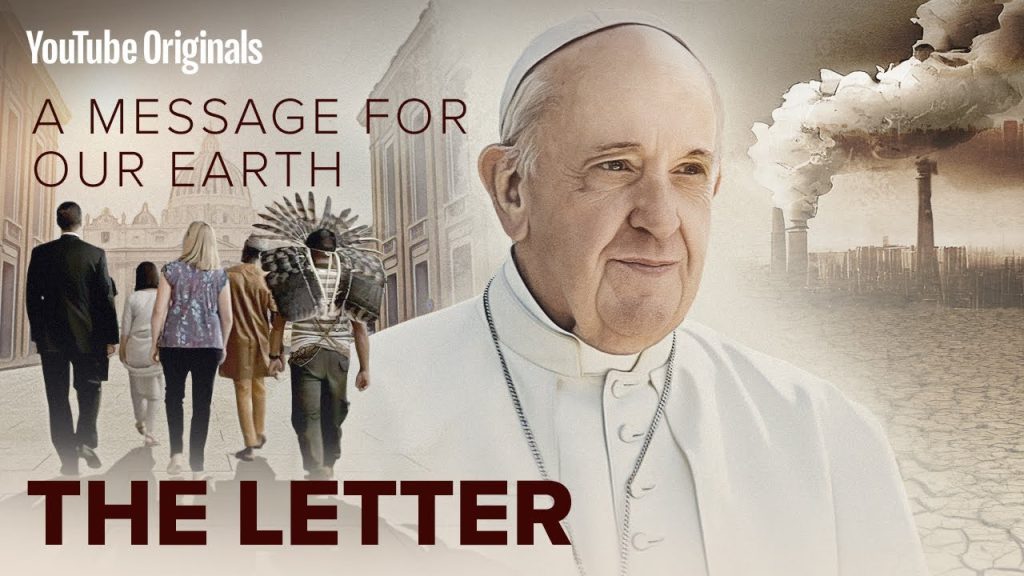Première partie de l'article
La trilogie nationale polonaise susmentionnée de Sienkiewicz... Le sang et le feu, L'inondation, Un héros polonaisest pour beaucoup la plus grande œuvre de l'écrivain. Il s'agit de trois romans historiques agrémentés de personnages fantastiques. Ce qui frappe le plus, c'est la connaissance approfondie de l'histoire de la Pologne au XVIIe siècle - Sienkiewicz s'est méthodiquement documenté -, l'utilisation d'une langue belle et archaïque, l'histoire d'amour passionnée qu'on y trouve, ainsi que leur publication périodique en chapitres dans la revue Słowo entre 1883 et 1886. Ce sont des romans historiques, et comme pour beaucoup de gens l'histoire est faite par les guerres, il y a une présence continue de scènes de bataille, avec des explications sur leurs motifs, la description des paysages et la présentation psychologique des personnages. Les moments les plus importants de l'histoire de la Pologne au XVIIe siècle, ses héros nationaux, ses nobles et ses chevaliers sont représentés. Le tout sous la devise "renforcer les cœurs", c'est-à-dire que Sienkiewicz veut encourager ses lecteurs à défendre leur patrie au XIXe siècle comme leurs ancêtres l'ont fait deux siècles plus tôt.
Dans le sang et le feu - Ogiem i mieczem (1883-1884) est un roman historique qui se déroule à l'époque des guerres cosaques et de l'Ukraine dans la région du Dniepr, pendant les années 1648-1654. La perte de ce qui aurait pu être la République des Trois Nations (Pologne, Lituanie et Ukraine). Le premier grand succès de Sienkiewicz, qui le plaçait déjà au sommet de la liste des prosateurs polonais. L'histoire d'amour du noble militaire Skrzetuski remplit toute la narration avec l'enlèvement de sa bien-aimée - un thème qu'il répète dans ses œuvres - avec sa recherche continue et la fin heureuse : "Le roi paie très bien pour les services mais le Roi des rois les paie avec le meilleur des cadeaux". Sienkiewicz voit la femme comme un cadeau, un cadeau du ciel.
Le site Potop (1884-1886), qui raconte l'histoire de la lutte contre l'invasion suédoise et la défense dans le sanctuaire de la forteresse de Jasna Góra à Częstochowa en 1655. Les chapitres tant attendus, leur diffusion et leur lecture étonnantes ont éveillé la conscience patriotique des paysans. Rappelons qu'à cette époque, dix pour cent de la population étaient des nobles et avaient une conscience profonde de leur identité polonaise. Les autres, les paysans, venaient de la campagne et ne se souciaient guère de savoir si les Russes, les Prussiens ou les Autrichiens étaient là, tant qu'on leur permettait de vivre bien et avec leurs coutumes. Mais la lecture L'inondation a réveillé chez beaucoup d'entre eux leur identité, à tel point qu'il a dit à Sienkiewicz : tu as fait de nous des Polonais !
Publier chapitre après chapitre de la L'inondationEn 1885, l'écrivain lutte contre la maladie dévastatrice de sa femme bien-aimée Maria, qui meurt en octobre 1885 à l'âge de trente et un ans au Balneario de Reichenhall en Bavière. Henryk est dévasté, mais il doit continuer à écrire, selon le fil narratif, des pages pleines d'espoir.
Un héros polonais (1887-1888) le titre original est Pan Wołodyjowski (M. Wołodyjowski). Il raconte l'histoire de ce chevalier militaire pendant la guerre de Turquie et se termine par la victoire de Sobieski sur les Turcs à Chocim (1673). Comme la république polonaise de l'époque avait un roi élu par les nobles, ce qui était unique en Europe, Jan III Sobieski a été élu roi et a de nouveau vaincu les Turcs à la bataille de Vienne (1683), et, paraphrasant Jules César, il a dit : venimus, vedimus, Deus vicit. Néanmoins, dans ce dernier volet de sa trilogie, Sienkiewicz raconte moins d'histoire, et dessine plutôt un roman d'aventure.
La Trilogie a donné aux lecteurs polonais un renforcement de leur cœur, de leurs espoirs pour le redressement de leur État, une leçon artistique de patriotisme, une foi dans la valeur de l'homme et de l'héroïsme. Dans ses histoires, les gens ordinaires deviennent des héros à imiter, des défenseurs de la justice, des vainqueurs de leurs ennemis, des hommes de prière et de foi chrétienne, des observateurs pieux de la loi de Dieu et de l'Église. Grâce à la Trilogie, Sienkiewicz commence à être une grande figure nationale, devenant une autorité littéraire et politique reconnue, certains le considèrent comme le chef spirituel de la nation. Personne n'a mieux su répondre au sentiment de fierté nationale des lecteurs polonais de toutes classes et générations. Ses livres étaient très lus à l'époque et le sont encore aujourd'hui. La trilogie est une lecture fluide, qui se lit avec plaisir et sans effort.
Quo vadis
Il est intéressant de réfléchir à la composition d'un livre, d'une œuvre littéraire classique. Il ne s'agit pas seulement d'un élément matériel ou d'un support électronique dans ses différents formats. Une œuvre littéraire existe réellement lorsqu'une personne la lit et en fait l'expérience. C'est pourquoi il y a autant de lectures et d'interprétations qu'il y a de lecteurs. Chacun d'entre nous se souvient d'un moment de sa vie où il a lu une œuvre de la littérature mondiale qui l'a profondément ému.
Mon premier souvenir de Quo vadis remonte à juin 1975, un mois de nombreux examens dans ma troisième année de mathématiques à l'université Complutense de Madrid. À cette époque, je me débattais personnellement avec le sujet de la statistique mathématique, que j'ai réussi à passer en juin. Cela confirme que l'étude, en plus d'être une tâche de l'intelligence, est avant tout un effort de la volonté de vouloir apprendre. J'étudiais dur dans une bibliothèque où il y avait un étudiant en droit qui lisait... Quo vadis sans s'arrêter. -Tu n'as pas d'examens en juin ? - Oui, mais je ne peux pas m'arrêter de lire ce roman. Je suis arrivé à la conclusion que l'on pouvait passer le droit sans étudier et que ce roman devait être passionnant.
L'hiver 1995 à Cracovie a été l'hiver le plus froid que j'ai passé en Pologne. Pendant plusieurs mois, le thermomètre a oscillé entre moins vingt et moins dix. Je me souviens d'un jour où il faisait moins cinq toute la journée et c'était génial. À cette époque, le chauffage de l'académie des étudiants où je vivais est tombé en panne, et jusqu'à ce qu'il soit décidé d'acheter un chauffage électrique, il a fait frais pendant deux semaines. J'étais dans ma chambre, assis à mon bureau, portant un manteau, des gants, un bonnet de laine et des doubles chaussettes aux pieds, et je lisais en polonais pour la première fois de ma vie, Quo vadis. Le directeur de la maison est arrivé avec un thermomètre et a dit : "Père, vous ne pouvez pas vous plaindre, votre chambre est à zéro degré, ni chaud ni froid. Je m'en fichais, parce que j'étais absorbé par ça, absorbé par... Quo vadis. Une lecture passionnante. Mais laissons les souvenirs personnels derrière nous et revenons à l'article.
Fort de l'expérience de la trilogie et de son succès, Sienkiewicz change de cadre : au lieu de l'histoire de la Pologne dans la seconde moitié du XVIIe siècle, nous allons à Rome, dans les dernières années de l'empereur Néron (63-68). Cependant, le système fonctionne de la même manière : l'histoire réelle et l'histoire fictive s'entremêlent dans un fil d'amour qui donne continuité, cohérence et tension à la lecture.
Quo vadis Selon une tradition légendaire, pendant la persécution des chrétiens par Néron, Pierre fuyait Rome en empruntant la voie Appienne. Il vit alors le Seigneur ressuscité qui allait dans la direction opposée, vers Rome, et lui dit : "Où vas-tu ? Quo vadis, Domine ? Ce à quoi Jésus répond : "Je vais être crucifié à Rome une seconde fois parce que vous avez abandonné mon troupeau". Honteux de sa lâcheté, Pierre retourne à Rome pour affronter son destin : le martyre.
Quo vadis raconte de façon magistrale ce qu'était Rome au premier siècle. Le fil historique du roman se concentre sur la personne de l'empereur romain Néron, ainsi que sur la persécution et la propagation de la foi chrétienne. Le contraste entre l'Empire romain et les premiers chrétiens est présenté. Il y a un contraste entre la débauche païenne du palais impérial et la puissance des raisons morales des disciples du Christ, qui deviendront plus tard la base de la construction de la civilisation européenne.
L'intrigue principale du roman est l'histoire d'amour entre Marcus Vinicius et Lygia. Ils appartiennent à deux mondes distincts : Vinicius est un patricien romain, membre de l'armée, Lygia appartient à une tribu barbare et est l'otage d'une famille romaine et chrétienne. L'intrigue amoureuse, logiquement fictive, a une influence décisive sur le déroulement de l'action dont la fuite de Ligia, la recherche de Vinicius pour retrouver sa bien-aimée, la tentative d'enlèvement, la transformation et le baptême de Vinicius et le salut miraculeux de Ligia dans le cirque sont les points forts. Le point culminant de l'intrigue est la confrontation d'Ursus, le protecteur de Lygia, avec le taureau. La victoire de l'homme sur l'animal dans l'arène du cirque symbolise une fin heureuse de l'intrigue, puisque Lygie, Vinicius et Ursus lui-même sont désormais aux mains du peuple romain. C'est un événement clé, car à ce moment précis, le peuple tourne le dos à Néron et se déclare en faveur des chrétiens.
Un personnage important de la pièce est Pétrone, un patricien romain, proche conseiller de Néron, qui est un exemple du goût et de l'élégance de l'Antiquité classique. arbiter elegantiaePetronius, symbolise la culture classique du passé, grandiose en comparaison de celle qui règne sous le règne de Néron, une culture en constant déclin. Au cours d'une lutte constante entre la vie et la mort, Pétrone critique l'idée de l'empereur et perd.
Le personnage le plus tragique et le plus comique est Chilon Chilonides, un sophiste sceptique et sans principes moraux. Il se fait passer pour un chrétien afin de les trahir. Il vend comme esclave la famille de Glaucus, un médecin chrétien d'origine grecque, qui, lui aussi trahi, meurt en martyr en pardonnant à Chilon. Grâce à cet exemple, le méprisable sophiste a subi un changement radical et est finalement mort sur la croix pour défendre ceux qu'il avait trahis : les chrétiens.
Dans ce grand roman, il convient de noter à quel point la Rome du premier siècle est bien dépeinte et écrite. Sienkiewicz était très bien documenté. On fait l'éloge de la grandeur de l'Empire romain avec ses vertus et ses défauts. Deuxièmement, la façon dont il dépeint les premiers chrétiens. Des hommes et des femmes passionnés par le Christ : les vertus de justice, d'honneur et de dignité, de pureté et de pauvreté sont admirables chez eux. C'étaient des chrétiens qui croyaient et priaient. Dans une bonne critique de ce roman, l'auteur se demandait si la description de ces premiers chrétiens, de leur vie exemplaire, est vraiment une invention de Sienkiewicz ou si cela s'est réellement produit.
C'est un récit plein de valeurs chrétiennes. Le premier d'entre eux est peut-être l'amour entre Vinicius et Lygia. Vinicius, qui a rencontré Lygia dans la famille romaine dont il est l'otage, l'invité et même le parent, tombe follement amoureux. Il veut la posséder en abusant d'elle dans les orgies de Néron, mais Lygia n'est pas consentante. Vinicius découvre peu à peu qu'il aime Lygia parce qu'il y a un secret en elle, quelque chose qui la rend forte, pure, juste. Vinicius découvre le grand secret de Lygia : elle est chrétienne. Marcus Vinicius cherche désespérément Lygia et veut gagner son amour, il commence donc à s'informer sur le christianisme. Ce qu'il découvre l'étonne : un tout nouveau monde, une nouvelle façon de penser, de vivre et de traiter les gens. Vinicius, en cherchant et en aimant Lygia, est comme inconsciemment en train de chercher et d'aimer son secret : Jésus-Christ.
Pour ceux qui n'ont pas encore lu Quo vadisJe recommande la lecture du chapitre VIII, trois pages dans ma version polonaise, ce qui, dans une lecture tranquille, prend dix minutes, et du chapitre XXXIII, cinq pages, environ quinze minutes, ce qui est un manque fondamental, mais je tiens à confirmer qu'il s'agit d'un roman de littérature classique et de valeurs chrétiennes profondes. Le chapitre huit décrit l'impression d'Akte, l'ancienne maîtresse de Néron, lorsqu'elle voit Lygia en prière, qui se trouve dans une situation désespérée. Akte n'a jamais vu personne prier de cette manière et a le sentiment qu'elle adresse ses mots à Quelqu'un qui la voit et que Lui seul peut l'aider.
Au chapitre trente-trois, il y a une déclaration d'amour entre Vinicius et Lygia ainsi que les apôtres Pierre et Paul. Certains chrétiens critiquent sévèrement Lygia pour être tombée amoureuse d'un païen, mais "Pierre s'approcha d'elle et lui dit : "Lygia, l'aimes-tu vraiment pour toujours ? Il y a eu un moment de silence. Ses lèvres se mirent à trembler comme celles d'un enfant qui est sur le point de fondre en larmes, qui, se sachant coupable, réalise en même temps qu'il doit reconnaître sa culpabilité. Réponds-moi ! a insisté l'apôtre. Puis humblement, d'une voix tremblante et en chuchotant, elle s'agenouille devant Pierre : "Oui, c'est vrai..." Vinicius au même moment s'agenouille aussi devant elle. Pierre étendit les mains et les posa sur leurs têtes en disant : "Aimez-vous les uns les autres dans le Seigneur et pour sa gloire, il n'y a pas de péché dans votre amour".
Le récit s'achève avec la mort de Néron et l'épitaphe finale : "Et ainsi Néron disparut comme disparaissent le vent et la tempête, le feu et les fléaux, mais la basilique Saint-Pierre continue de dominer la ville et le monde depuis la colline du Vatican. À l'endroit où se trouvait autrefois la porte de Capena, se trouve aujourd'hui une petite chapelle avec une faible inscription : Quo vadis, Domine ?" Une question d'actualité que Sienkiewicz relie à la Quo vadis, homine ?Où va l'homme s'il perd son humanité ? Mais il y a encore de l'espoir, et la souffrance et le martyre des chrétiens ont porté leurs fruits, tout comme la souffrance des héros polonais.
Le roman a rapidement connu un succès incroyable dans le monde entier. Plus d'une centaine d'éditions ont été publiées en français et en italien. En 1916, quand Sienkiewicz est mort, le tirage de Quo vadis Rien qu'aux États-Unis, il s'est vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires. Il a été traduit dans plus de quarante langues et jouit à ce jour d'une popularité exceptionnelle.
La personnalité de Sienkiewicz
Beaucoup disent que Henryk Sienkiewicz s'identifie étroitement au personnage de Petronius, arbiter elegantiaede son Quo vadisqui ont réellement existé. Cultivé, distant, élégant, quelque peu sceptique, avec un goût pour la beauté, surtout chez les femmes, mais toujours avec délicatesse et respect. Il utilise une critique ironique et humoristique de la réalité dans laquelle il vit.
Après avoir terminé la Trilogie, Sienkiewicz a publié deux romans contemporains : Bez dogmatu - Pas de dogme y Rodzina Połanieckich - La famille Polaniecki. Sous la forme d'un journal intime, ils contiennent de nombreux détails autobiographiques. Pas de dogme est le journal des pensées d'un riche comte polonais vivant avec son père à Rome, un visiteur fréquent des salons européens, un exemple de "l'improductivité slave" dans l'analyse constante de la beauté et de l'esprit humain.
Quelqu'un m'a demandé récemment si Sienkiewicz était un croyant. Je ne savais pas comment lui répondre, ni à la question de savoir s'il était catholique pratiquant, cette dernière étant plus facile à trouver une réponse parce qu'elle est un fait empirique. Ce qui ressort clairement de ses œuvres, c'est que l'histoire de la Pologne ne peut être comprise sans le christianisme, tout comme Sienkiewicz ne peut comprendre sa propre vie sans la foi catholique et la dévotion à la Mère de Dieu. Sa pensée est catholique mais théologiquement non réfléchie. Il me semble que les courants philosophiques de l'époque, dont il était aussi un lecteur très assidu, l'ont conduit à un scepticisme qu'il a voulu dépasser par un volontarisme : je veux croire.
Écrire Pas de dogmeJ'attends qu'il me soit donné un état d'âme dans lequel je puisse croire fermement et sans aucun mélange de doutes, croire comme je croyais quand j'étais enfant. J'ai de nobles motivations, je ne cherche aucun intérêt personnel parce qu'il serait plus confortable pour moi d'être un animal heureux et engraissé (...) Dans ce grand "je ne sais pas" de mon âme, j'essaie de respecter toutes les normes religieuses et je ne me considère pas comme un homme insincère. Je le serais si, au lieu de dire "Je ne sais pas", je pouvais dire : "Je sais qu'il n'y a rien". Mais notre scepticisme n'est pas un déni ouvert, c'est plutôt une intuition douloureuse et pénible qu'il n'y a peut-être rien, c'est un brouillard dense qui nous entoure la tête, nous presse la poitrine et nous couvre de la lumière. Alors je tends les mains vers ce soleil qui brille à travers le brouillard. Je pense que je ne suis pas seul dans cette situation, que la prière de beaucoup, de beaucoup de ceux qui vont à la messe le dimanche, pourrait se résumer à ces mots : "Seigneur, disperse le brouillard !"
La famille Polaniecki est une défense du rôle social de la noblesse et de la bourgeoisie, ainsi qu'une apothéose ouverte du traditionalisme catholique. Le protagoniste du roman est un noble appauvri qui fait des affaires à Varsovie. Pendant l'écriture de ce roman, il a rencontré Maria Romanowska, la fille adoptive d'un riche homme d'Odessa. Henryk a maintenant quarante-six ans, Maria dix-huit. Toutes deux ont des doutes, mais la mère, fascinée par la lecture de Pas de dogmeIl a fait pression sur sa fille pour qu'elle se marie. Le mariage a eu lieu à Cracovie en 1893 et ils ont été mariés par le cardinal-évêque de Cracovie. La belle-mère est passée de la fascination pour Sienkiewicz à la réprobation. Elle a entrepris des démarches pour faire annuler le mariage par le Vatican, ce qui a été réalisé moins d'un an après la cérémonie de mariage. Sienkiewicz a reçu la confirmation papale de la non-existence du sacrement du mariage avec peine et douleur. La désagréable aventure d'une belle-mère qui fait et défait est dépeinte dans les pages de La famille Polaniecki.
Les croisés
Peu de temps après, l'écrivain a prévu de visiter les camps de Grunwald - il était en train d'écrire Krzyżacy - Les croisésL'histoire des chevaliers teutoniques au 15e siècle - mais il n'a pas obtenu la permission de la police prussienne. Au lieu de cela, il a rencontré une autre Maria : "Une belle femme de Wielkopolska, Mlle Radziejewska, qui a fait sur moi une impression électrisante. Elle était journaliste, alors âgée de vingt-trois ans, Sienkiewicz de cinquante-trois ans. C'était une femme très belle et intelligente, mais Henryk, bien qu'il soit très amoureux d'elle, a découvert une anomalie psychique chez elle. Après les tristes expériences du second mariage, l'écrivain a décidé de rompre la relation. Des années plus tard, le déséquilibre de cette quatrième Maria a été tragiquement confirmé.
La combinaison de l'aventure chevaleresque et de la romance peut être trouvée dans Les croisés (1900). Il s'agit d'une grande peinture historique dont le contenu est plus large, plus profond et plus précis que toutes ses œuvres précédentes. L'épopée raconte l'histoire des luttes polono-neutoniennes, pleine d'un fort sentiment patriotique, et constitue la réponse de Sienkiewicz aux abus des Prussiens.
L'idée d'écrire Les croisés est né de la constatation des abus commis par les autorités prussiennes à l'encontre de la population polonaise. La plus grave fut la cruelle persécution d'enfants et de leurs parents à Września, une ville proche de l'actuelle Poznań, qui protestaient contre l'enseignement de la religion en allemand à l'école. Il n'était pas permis de parler polonais à l'école, mais le fait que la religion catholique soit enseignée en allemand a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les Polonais. Henryk a pris une part active aux actions de protestation contre eux. La description finale de la bataille victorieuse de Grunwald (1410) a fait adopter le roman dès le début comme une œuvre d'actualité politique, et les événements historiques ultérieurs - avec la défaite de l'Allemagne dans les deux guerres mondiales - l'ont rendu presque prophétique.
La dernière Marie et son activité sociale
En 1904, Sienkiewicz, âgé de 58 ans, a épousé Maria Babska, 42 ans. Cette femme était sa cousine, et elle était amoureuse de lui depuis longtemps, car ils se connaissaient depuis longtemps en tant que parents. Le mariage était intime, uniquement en compagnie des personnes aimées. Les Sienkiewicz se sont retrouvés et ont vécu ensemble douze années heureuses, jusqu'à la mort de l'écrivain.
Henryk Sienkiewicz était un grand travailleur social, promouvant et finançant de nombreuses initiatives sociales : musées, fondations pour promouvoir la culture, la recherche scientifique ou la promotion de jeunes écrivains. Il a promu des sanctuaires pour les enfants atteints de tuberculose et a financé la construction d'églises. Dans les dernières années de sa vie, il a intensifié sa coopération dans des projets sociaux avec l'aide de sa femme.
Le début de la Première Guerre mondiale (1914) surprend Sienkiewicz à Oblęgorek, sa résidence de palais - Dworek - près de Varsovie, d'où il part pour la Suisse via Cracovie et Vienne. Avec la participation d'Ignacy Jan Paderewski, il organise à Vevey le Comité général suisse d'aide aux victimes de la guerre en Pologne, envoyant de l'argent, des médicaments, de la nourriture et des vêtements à un pays dévasté par des armées en guerre.
Son dernier grand roman : A travers la jungle et les steppes.
Le roman pour les jeunes W pustyni i w puszczy - À travers la forêt et les steppes (1911) est le dernier grand roman d'aventure avec lequel il a conclu sa carrière d'écrivain de plus de quarante ans. Ce roman d'aventure, qui témoigne de l'influence de Jules Verne, raconte le périple de deux enfants enlevés par des musulmans lors du soulèvement du Mahdi au Soudan (1881-1885). Ils parviennent à s'échapper et à traverser tout le continent africain avant d'être retrouvés, déjà au bord de la mort, par une équipe de secours. L'auteur utilise ses propres expériences lors de son voyage en Afrique. Il a toute la maîtrise de ses grandes œuvres, très facile à lire, surtout pour les jeunes.
L'amour de sa patrie et sa mort en Suisse
En 1905, en réponse à une interview accordée au journal parisien Le Courrier EuropéenIl a déclaré : "Vous devez aimer votre patrie par-dessus tout et penser avant tout à son bonheur. Mais en même temps, le premier devoir d'un vrai patriote est de faire en sorte que l'idée de sa patrie non seulement ne s'oppose pas au bonheur de l'humanité, mais en devienne un des fondements. Ce n'est que dans ces conditions que l'existence et le développement de la Patrie deviendront un sujet de préoccupation pour l'ensemble de l'humanité. En d'autres termes, le slogan de tous les patriotes doit être : pour la patrie à l'humanité, et non : pour la patrie contre l'humanité".
Henryk Sienkiewicz est mort comme il a vécu, en travaillant à l'étranger. Sa dernière œuvre est un roman de l'époque napoléonienne. Légionnaire – Légionsune œuvre qui a été publiée à titre posthume. Il est décédé dans sa résidence temporaire de Vevey, en Suisse, d'une crise cardiaque. En 1924, dans la Pologne libre, les cendres de l'écrivain sont solennellement apportées de Vevey au pays. Sa dépouille repose dans la cathédrale Saint-Jean de Varsovie.
Concluons en soulignant que le talent littéraire de Henryk Sienkiewicz se mesure à sa capacité à utiliser des mots empruntés à la langue d'époques révolues, avec l'emploi de termes qui rendent le style de cet écrivain unique. En outre, l'auteur de la Trilogie a apporté une contribution décisive à la formation de la conscience nationale des Polonais du XIXe siècle. Witold Gombrowicz, célèbre écrivain et critique de la littérature polonaise, a écrit ces mots dans son Journal (1953 - 1956) : " Qui a lu Mickiewicz de son plein gré, qui a connu Słowacki ? Mais Sienkiewicz est le vin avec lequel on s'enivre vraiment. Ici, notre cœur bat... et quel que soit votre interlocuteur, un médecin, un ouvrier, un professeur, un propriétaire terrien, un employé de bureau, vous rencontrerez toujours Sienkiewicz. Sienkiewicz est le dernier et le plus intime secret du goût polonais : le rêve de la beauté polonaise".
Henryk Sienkiewicz est toujours considéré comme un classique du roman historique, l'un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature polonaise et un styliste hors pair. Les listes bibliographiques internationales prouvent que Sienkiewicz est l'un des écrivains polonais les plus populaires dans le monde. Ses œuvres continuent de paraître sous forme de réimpressions et de nouvelles traductions.














 Trouvez votre âme en Terre Sainte
Trouvez votre âme en Terre Sainte