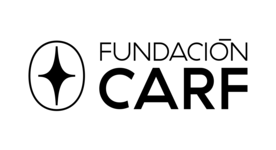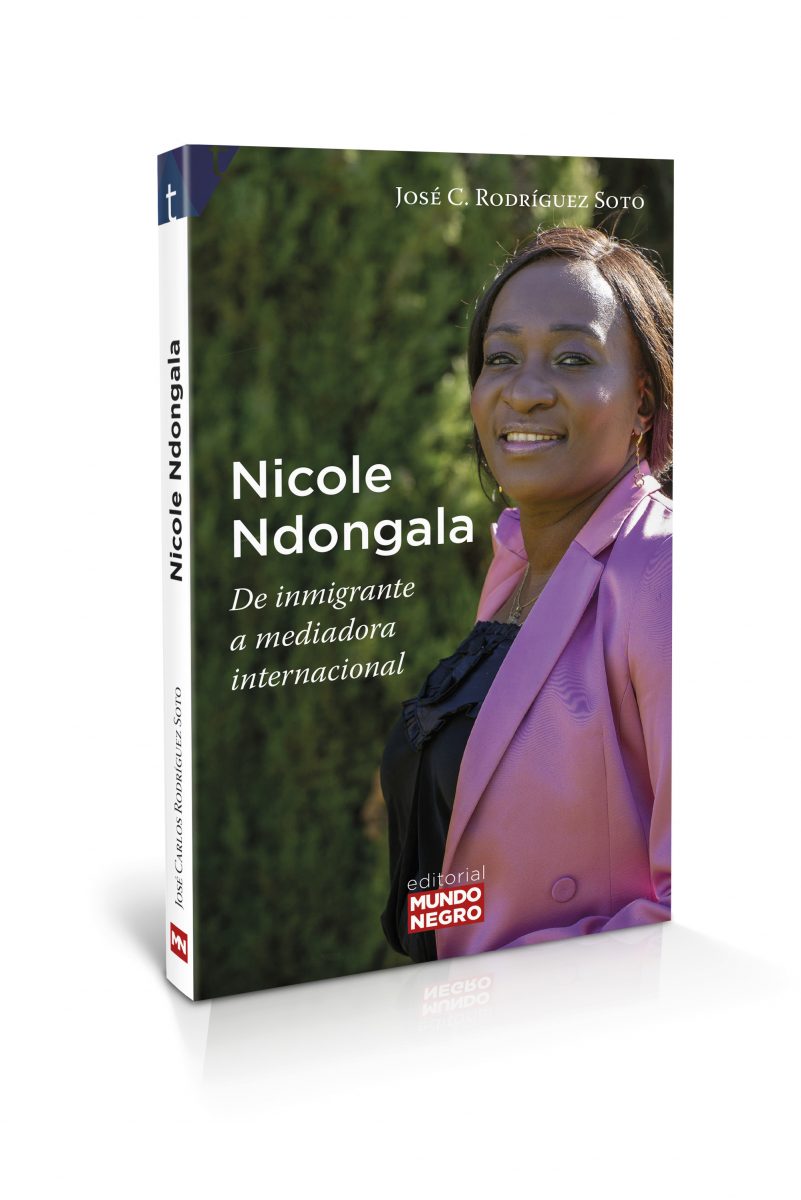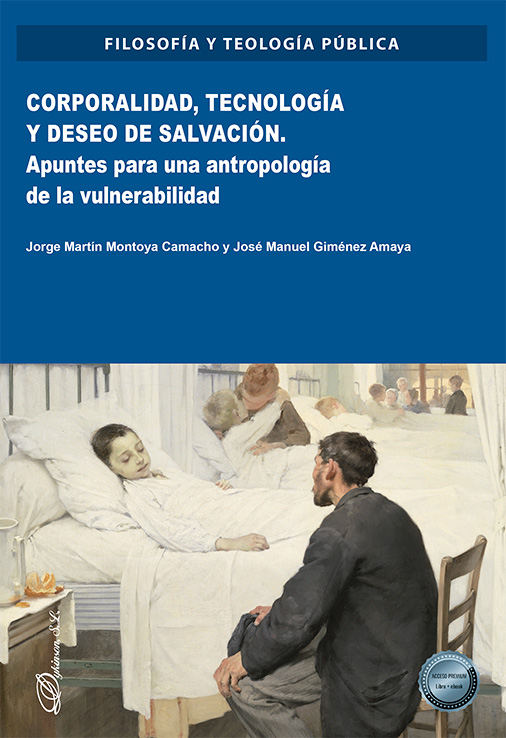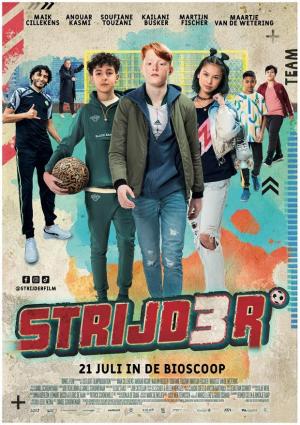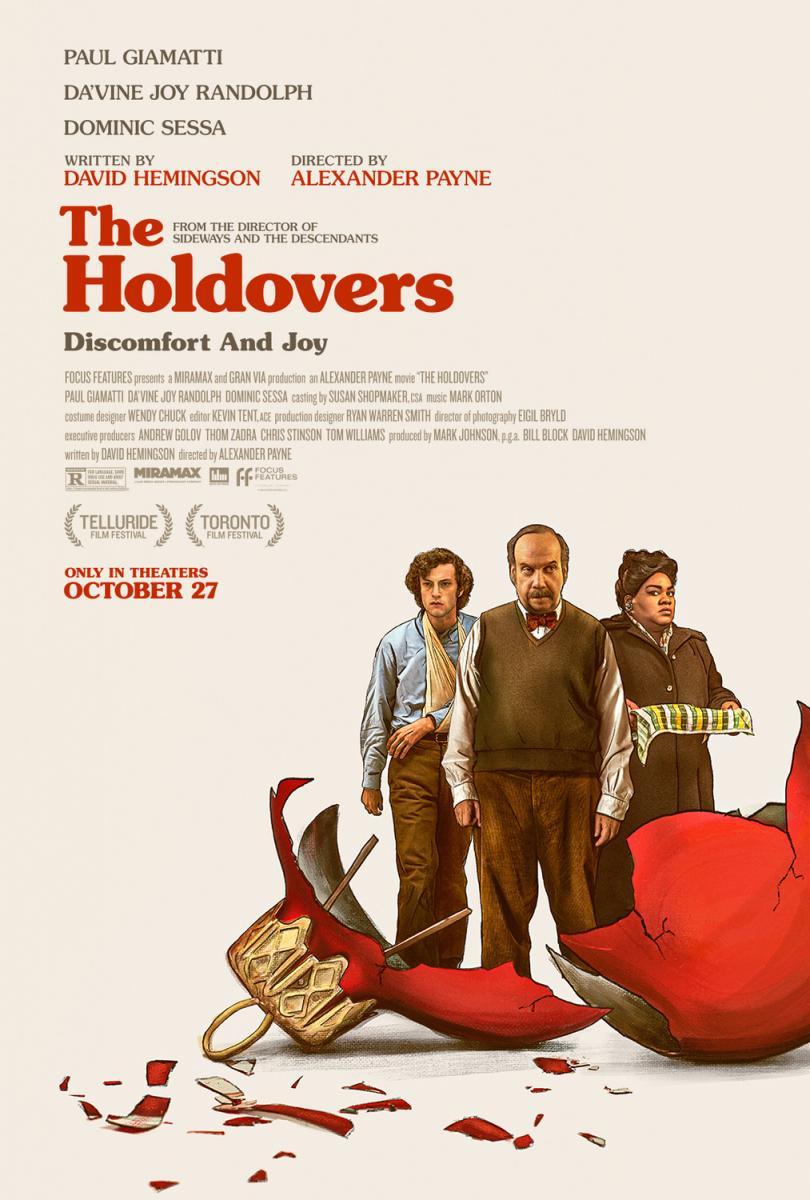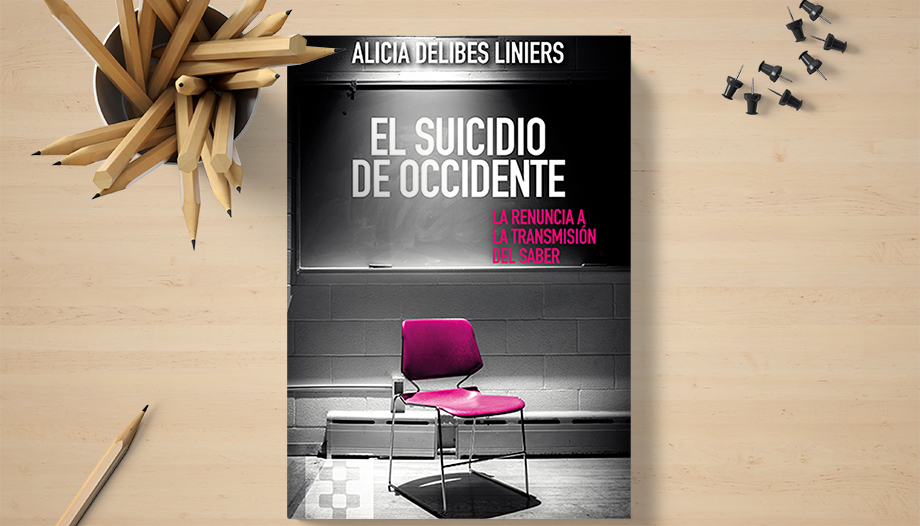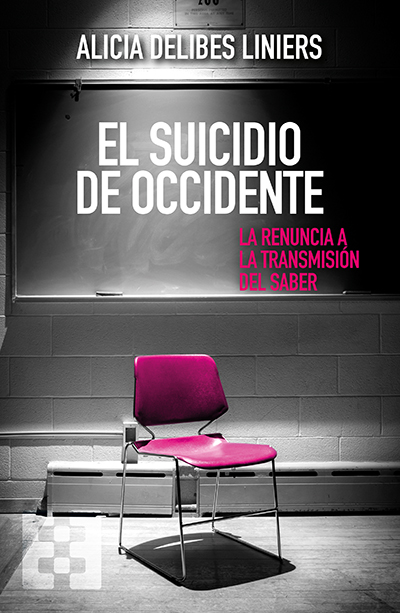En quoi un être vivant est-il semblable à une cathédrale ? La tradition chrétienne a comparé la vie chrétienne à un organisme vivant et à une cathédrale. Dans les deux cas, une harmonie est atteinte, sans que la tension entre les différents éléments qui composent les deux réalités ne disparaisse.
On pourrait donc dire que la vie chrétienne, soutenue par les vertus, est comme une "cathédrale vivante" : un édifice spirituel que chaque chrétien contribue, par toute sa vie, à construire en lui-même et dans les autres ; et qui s'élève, plein de beauté, pour la gloire de Dieu et une vie plus pleine pour l'humanité.
Le mercredi 22 mai s'est achevée la catéchèse du Pape sur la vices et vertusLe premier d'entre eux a eu lieu le 27 décembre de l'année dernière. Au total, il y a eu vingt-et-un mercredis presque sans interruption. François a développé son enseignement en deux parties principales.
Pour poursuivre notre métaphore, dans la première partie, il met en garde contre les déformations ou les défauts possibles de cette "cathédrale vivante" (les vices) ; dans la deuxième partie, il présente la beauté et l'harmonie de certains des principaux éléments (les vertus).
La lutte contre les vices de capital
Les deux premiers mercredis ont été consacrés à l'introduction du thème en soulignant deux aspects clés de la vie chrétienne. Tout d'abord, la garde du cœur (cf. Audience générale 27-VII-2023).
Le livre de la Genèse (ch. 3) présente la figure du serpent, séducteur et dialectique, avec sa tentation autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était une mesure de prudence que Dieu avait utilisée avec l'homme et la femme, pour les préserver de la présomption de toute-puissance : une menace dangereuse et toujours présente.
Mais ils ont dialogué avec le diable, ce qui ne devrait jamais être fait. "Le diable est un séducteur. Ne dialoguez jamais avec lui, car il est plus malin que nous tous et il nous le fera payer. Quand la tentation arrive, ne dialoguez jamais. Fermez la porte, fermez la fenêtre, fermez votre cœur.". Être gardien du cœur, souligne le pape, est une grâce, une sagesse et un trésor à demander.
Deuxièmement, le combat spirituel (cf. Audience générale 3-I-2024). "Vie chrétienne -François déclare... exige un combat permanent"pour conserver la foi et en enrichir les fruits en nous. Déjà avant le baptême, les catéchumènes reçoivent une onction qui les aide et les fortifie pour ce combat : "...conserver la foi et en enrichir les fruits en nous".Le chrétien doit lutter : son existence, comme celle de tout un chacun, devra aussi descendre dans l'arène, car la vie est une succession d'épreuves et de tentations.".
Mais les tentations ne sont pas une mauvaise chose en soi. Jésus lui-même s'est aligné sur les pécheurs pour être baptisé par Jean dans le Jourdain. Et il a voulu être tenté dans le désert pour nous donner l'exemple et nous assurer qu'il est toujours à nos côtés.
"C'est pourquoi -dit le successeur de Pierre. il est important de réfléchir aux vices et aux vertus".. Ce "nous aide à surmonter la culture nihiliste dans laquelle les lignes entre le bien et le mal restent floues et, en même temps, nous rappelle que l'être humain, contrairement à toute autre créature, peut toujours se transcender, en s'ouvrant à Dieu et en marchant vers la sainteté.".
Plus précisément, "le combat spirituel nous amène à regarder de près les vices qui nous entravent et à marcher, avec la grâce de Dieu, vers les vertus qui peuvent fleurir en nous, apportant le printemps de l'Esprit dans nos vies.".
En étroite relation avec ce que la catéchèse chrétienne appelle les péchés capitaux, l'évêque de Rome s'est attardé sur certains vices (cf. Audiences générales du 10 janvier au 6 mars) : la gourmandise, qui doit être vaincue par la sobriété ; la luxure, qui dévaste les relations entre les personnes et sape le sens authentique de la sexualité et de l'amour ; la cupidité, qui s'oppose à la générosité, en particulier envers les plus démunis ; la colère, qui est une forme de violence qui n'est pas seulement une forme de violence, mais aussi une forme de violence, qui est une forme de violence qui n'est pas seulement une forme de violence, qui est une forme de violence, qui est une forme de violence., qui détruit les relations humaines jusqu'à en perdre la lucidité, alors que le Notre Père nous invite à pardonner comme on nous a pardonné ; la tristesse de l'âme qui se referme sur elle-même, sans se rappeler que le chrétien trouve toujours la joie dans la résurrection du Christ ; la paresse, surtout sous forme d'acédie (qui inclut un manque de ferveur dans la relation avec Dieu) ; l'envie et la vaine gloire, qui se soignent par l'amour de Dieu et du prochain ; et enfin, l'orgueil, qui s'oppose à l'humilité.
Agir de manière vertueuse
Après la catéchèse sur les vices, venait la catéchèse sur les vertus., en commençant par une considération générale de l'action vertueuse (General Hearing, 13-III-2024). "L'être humain -a expliqué le pape. est fait pour le bien, ce qui le comble vraiment, et il peut aussi pratiquer cet art, en rendant permanentes en lui certaines dispositions". Ce sont les vertus. Le terme latin Virtus souligne la force qu'implique toute vertu. Le Grec areta désigne quelque chose qui se distingue et suscite l'admiration.
Les vertus ont permis aux saints d'être pleinement eux-mêmes, de réaliser la vocation propre à l'être humain. "Dans un monde déformé, nous devons nous souvenir de la forme dans laquelle nous avons été façonnés, de l'image de Dieu qui est à jamais imprimée en nous.".
La vertu nécessite une lente maturation, car il s'agit d'une "vertu".volonté habituelle et inébranlable de faire le bien" (Catéchisme de l'Église catholique1803), fruit de l'exercice de la vraie liberté dans chaque acte humain. Pour acquérir la vertu, il faut d'abord la grâce de Dieu, mais aussi la sagesse, don de l'Esprit Saint, qui implique l'ouverture d'esprit, l'apprentissage des erreurs, la bonne volonté (capacité à choisir le bien, par l'exercice de l'ascèse et l'évitement des excès).
Un excellent livre sur les vertus est celui de Guardini, publié en espagnol sous le titre Une éthique pour notre temps, dans le même volume qu'une autre de ses œuvres, L'essence du christianismeMadrid 2006, pp. 207 et suivantes.
Le successeur de Pierre a expliqué : "Reprenant les auteurs classiques à la lumière de la révélation chrétienne, les théologiens ont imaginé le septénaire des vertus - les trois vertus théologales et les quatre vertus cardinales - comme une sorte d'organisme vivant dans lequel chaque vertu occupe un espace harmonieux. Il y a des vertus essentielles et des vertus accessoires, comme des piliers, des colonnes et des chapiteaux. Rien de tel peut-être que l'architecture d'une cathédrale médiévale pour donner une idée de l'harmonie qui existe dans l'être humain et de sa tension permanente vers le bien."(Audience générale, 20-III-2024).
Le Pape analyse les vertus telles qu'elles sont présentées de manière phénoménologique ou décrites selon la sagesse humaine ; il les examine à la lumière de l'Évangile, en se référant au Catéchisme de l'Église catholique ; et, sans oublier les obstacles que nous pouvons rencontrer aujourd'hui sur le chemin de ces vertus, il indique les moyens de les atteindre ou de les accroître.
François a exposé les vertus cardinales dans l'ordre traditionnel : la prudence (qu'il a complétée par la patience), la justice, la force morale et la tempérance. Cela s'est fait lors des audiences générales du 20 mars au 17 avril.
C'est prudent", a-t-il déclaré, "qui sait".garder la mémoire du passé"En même temps, il sait prévoir, penser à l'avance, afin d'obtenir les moyens nécessaires pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Dans l'Évangile, les exemples de prudence sont nombreux (cf. Mt 7, 24-27 ; Mt 25, 1-3).
Et le Seigneur encourage la combinaison de la simplicité et de la ruse lorsqu'il dit :".Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ; soyez sages comme des serpents et inoffensifs comme des colombes."(Mt 10, 16). Et le Pape interprète : "C'est comme si l'on disait que Dieu ne veut pas seulement que nous soyons des saints, mais qu'il veut que nous soyons des "saints intelligents", car sans prudence, se tromper de chemin est l'affaire d'un instant !".
Selon lui, la justice devrait caractériser notre vie quotidienne et imprégner notre langage avec simplicité, sincérité et gratitude. Elle conduit à la révérence et au respect des lois, à la recherche du bien de tous, et donc à surveiller son propre comportement, à demander pardon ou à sacrifier un bien personnel si nécessaire. Elle recherche l'ordre et abhorre le favoritisme. Elle aime la responsabilité et est exemplaire.
En ce qui concerne la force, il a observé : "Dans notre Occident confortable, qui a un peu "édulcoré" tout, qui a transformé le chemin de la perfection en un simple développement organique, qui n'a pas besoin de se battre parce que tout lui semble identique, nous ressentons parfois une saine nostalgie des prophètes (...) Nous avons besoin de quelqu'un qui nous soulève du "mou" dans lequel nous nous sommes installés et qui nous fasse répéter résolument notre "non" au mal et à tout ce qui conduit à l'indifférence.(...) ; "oui" à la voie qui nous fait progresser, et pour laquelle nous devons nous battre".
Il a expliqué que la vertu cardinale de la contemplation est la maîtrise de soi, qui conduit à la maturité personnelle et sociale.
La vie de grâce selon l'Esprit
François enseigne que les vertus cardinales n'ont pas été remplacées par le christianisme, mais qu'elles ont été concentrées, purifiées et intégrées à la foi chrétienne dans ce que nous appelons "les vertus cardinales".la vie de grâce selon l'Esprit"(cf. Audience générale, 24-IV-2024).
À cette fin, le baptême instille en nous les germes de trois vertus que nous appelons vertus théologales, parce qu'elles sont reçues et vécues dans la relation avec Dieu (vie de grâce) : la foi, l'espérance et la charité (cf. Catéchisme de l'Église catholique, 1813).
"Le risque des vertus cardinales -a déclaré le pape. est de générer des hommes et des femmes qui sont héroïques en faisant le bien, mais qui agissent seuls, isolés". "D'autre part a-t-il répondu, le grand don des vertus théologales est l'existence "vécue dans l'Esprit Saint".. Le chrétien n'est jamais seul. Il fait le bien non pas par un effort titanesque d'engagement personnel, mais parce que, en humble disciple, il marche derrière le Maître Jésus. Il montre le chemin. Le chrétien possède les vertus théologales, qui sont le grand antidote à l'autosuffisance.".
C'est précisément pour éviter cela que les vertus théologales sont d'une grande aide : parce que nous sommes tous pécheurs et que nous commettons souvent des erreurs ; parce que "... nous sommes tous pécheurs et que nous commettons souvent des erreurs".L'intelligence n'est pas toujours lucide, la volonté n'est pas toujours ferme, les passions ne sont pas toujours gouvernées, le courage ne surmonte pas toujours la peur.". "Mais si nous ouvrons notre cœur à l'Esprit Saint, le Maître intérieur, il ravive en nous les vertus théologales. Ainsi, lorsque nous perdons confiance, Dieu augmente notre foi ; lorsque nous nous décourageons, il réveille en nous l'espérance ; et lorsque nos cœurs se refroidissent, il les rallume au feu de son amour.". La foi - dira-t-il le mercredi suivant - nous permet de voir même dans l'obscurité ; la charité nous donne un cœur qui aime même quand il n'est pas aimé ; l'espérance nous rend intrépides contre toute espérance.
François a parlé des vertus théologales lors des audiences générales du 1er au 15 mai.
Il a souligné qu'un grand ennemi de la foi est la peur (cf. Mc 4, 35-41), qui est surmontée par la confiance en notre Père céleste. L'espérance est la réponse au sens de la vie et s'appuie également sur la puissance de la résurrection du Christ, qui permet d'avoir un cœur jeune comme celui de Siméon et d'Anne. La charité, contrairement à l'amour qui est sur les lèvres de beaucoup de gens les influenceurs, a trait au véritable amour de Dieu et du prochain : "...Non pas l'amour qui monte, mais l'amour qui descend ; non pas l'amour qui enlève, mais l'amour qui donne ; non pas l'amour qui apparaît, mais l'amour qui est caché."."L'amour est la "porte étroite" par laquelle nous devons passer pour entrer dans le Royaume de Dieu. En effet, au soir de la vie, nous ne serons pas jugés sur l'amour générique, mais jugés précisément sur la charité, sur l'amour que nous avons concrètement donné."(cf. Mt 25, 40).
Enfin, le Pape a consacré une audience à l'humilité (cf. Audience générale du 22 mai 2024). "L'humilité ramène tout à la bonne dimension : nous sommes des créatures merveilleuses, mais nous sommes limités, avec des mérites et des défauts."(cf. Gn 3,19). Pour les chrétiens, la science nous aide à nous émerveiller du mystère qui nous entoure et nous habite, sans orgueil ni arrogance.
Un modèle d'humilité, a-t-il conclu, est avant tout Marie, comme elle le manifeste dans son chant Magnificat.
 Pourquoi se marier ? Le mariage chrétien au 21ème siècle
Pourquoi se marier ? Le mariage chrétien au 21ème siècle Cédric et Sophie Barut, le témoignage d'un mariage "hors norme
Cédric et Sophie Barut, le témoignage d'un mariage "hors norme