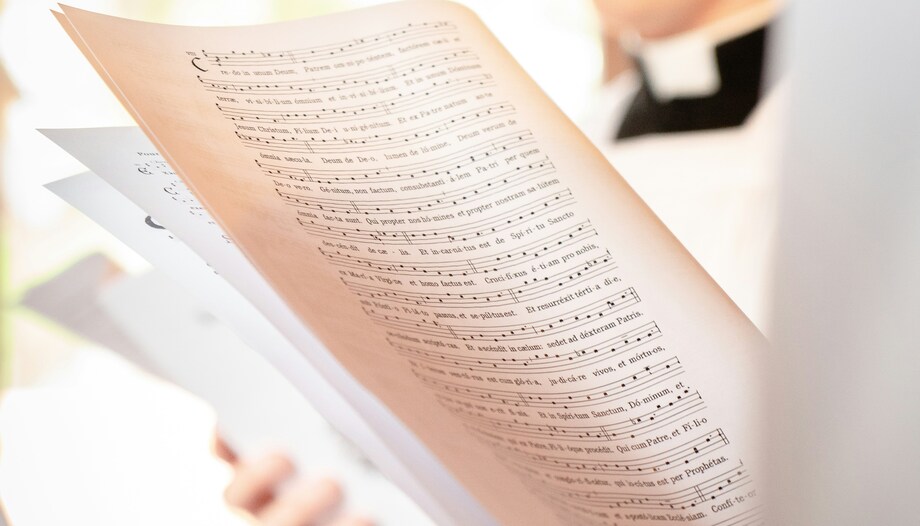Timothy McDonell est le directeur du département de musique sacrée de l'Institut de musique de l'Union européenne. Hillsdale Collegeoù il dirige la chorale de la chapelle de l'université. Auparavant, M. McDonnell a dirigé le programme d'études supérieures en musique sacrée à l'Université catholique d'Amérique. Il a également été chef de chœur du Pontifical North American College Choir au Vatican avant de retourner aux États-Unis en 2008.
Grâce à son travail universitaire et professionnel, Timothy McDonnell a approfondi sa compréhension de la relation étroite qui existe entre le chant grégorien et la musique de l'Église catholique. liturgie Catholique. L'une ne pouvant être comprise sans l'autre, le directeur de la musique sacrée encourage les catholiques à redonner au chant grégorien la place qui lui revient dans la liturgie et à reconnaître son héritage.
Comment définiriez-vous le chant grégorien en termes musicaux et spirituels, et qu'est-ce qui le rend unique dans le contexte liturgique catholique ?
- Cela nous amène au cœur du problème, car toute musique sacrée est spéciale et réservée à des fins sacrées. Mais le chant grégorien présente des caractéristiques particulières qui, à mon avis, le rendent particulièrement adapté à la liturgie catholique et reflètent la spiritualité de cette liturgie.
Parmi les caractéristiques que je citerais, il y a le caractère direct, car le chant grégorien est une forme musicale simple, avec une seule ligne musicale. Il présente donc une certaine simplicité, mais il s'agit en même temps d'une musique très raffinée. C'est une musique qui a mis des siècles à être créée, mais elle conserve ce caractère direct et cette simplicité dans son expressivité.
L'autre élément que je mentionnerais est qu'il provient d'une tradition, ce qui, à mon avis, est très important dans un contexte religieux, car le principe de la religion est qu'il y a une transmission, que nous transmettons le Christ et sa mission aux apôtres.
L'idée d'une tradition musicale dans l'Église est une sorte de symbole de ce processus de transmission du trésor. Ainsi, la musique elle-même est une sorte de métaphore de la tradition en termes musicaux. Par exemple, les différents modes ou tonalités dans lesquels le chant grégorien est composé sont dérivés d'anciennes formules de récitation et de chant des Psaumes.
Le troisième point que je voudrais souligner est que la liturgie elle-même est conçue et coordonnée parfaitement avec le chant liturgique. Le chant grégorien se réfère toujours à quelque chose d'extérieur à lui-même : à la liturgie d'une part, et à l'Écriture Sainte d'autre part. Il s'agit donc d'une musique profondément biblique. D'une certaine manière, il incarne le chant de l'Écriture.
Quelle a été l'influence la plus profonde du chant grégorien sur l'évolution de la liturgie catholique ?
- La liturgie s'est progressivement transformée au fil du temps. Il s'agit là d'une constatation importante, car la liturgie et sa musique se sont développées ensemble. Par exemple, entre le 7e et le 9e siècle, le chant grégorien a été composé par le clergé responsable de la création de notre calendrier liturgique.
Ces musiciens clercs choisissaient des textes liturgiques qui suggéraient eux-mêmes un contenu mélodique. En d'autres termes, la mélodie émerge du texte. Ainsi, lorsque le texte est modifié, il y a une influence sur la liturgie.
Le Concile Vatican II a apporté des changements significatifs à la liturgie. Comment voyez-vous la relation entre le chant grégorien et les réformes liturgiques de cette période ?
- Il s'agit là d'un point extrêmement important. En fait, c'est peut-être la considération la plus importante en termes de musique et de liturgie à notre époque. En effet, si la musique est quelque chose qui se transmet de génération en génération comme un trésor, nous devons comprendre les réformes liturgiques dans le contexte de la réception de ce trésor. Ainsi, si nous nous éloignons trop de ce que nous apprenons du trésor musical de l'Église dans la manière dont nous poursuivons la réforme liturgique, il y aura un trop grand décalage avec notre tradition.
Je pense qu'il est essentiel que nous comprenions que la musique nous fournit un contexte dans lequel nous pouvons comprendre tous les autres changements rituels qui ont eu lieu. Je peux en donner quelques exemples positifs et peut-être négatifs.
Il y a eu, par exemple, un processus de récupération dans la liturgie de l'office divin autour des hymnes de l'office divin. En effet, au XVIIe siècle, il y a eu une révision des hymnes qui a modifié les hymnes originaux, et tous les textes ont été recréés. Et nous avons perdu quelque chose de très important à cause de ces changements.
Après le Concile Vatican II, une chose merveilleuse s'est produite : ces hymnes ont été restaurées. Ils sont donc devenus les hymnes officiels de l'Office divin. Il s'agit d'un exemple positif où la restauration nous a appris quelque chose sur notre passé et où nous avons eu une sorte de restauration.
Mais ces choses n'ont pas été prises particulièrement au sérieux par la génération qui a suivi le Concile Vatican II et les idéaux ont été revus à la baisse. Je pense que cela est dû en partie à des circonstances pratiques. Il y a eu une perte d'énergie et de vigueur dans la poursuite de ces objectifs.
La bonne nouvelle, c'est que les jeunes générations s'intéressent de plus en plus à la recherche de l'énergie nécessaire pour faire ce que le Concile a demandé, à savoir restaurer le chant grégorien et en faire un mode de prière central pour l'ensemble de l'Église.
D'autre part, il faut noter que la prière de la messe a été raccourcie dans la liturgie réformée, alors que la musique est parfois trop longue. Voilà donc un cas où musique et liturgie ne sont pas compatibles d'une certaine manière. C'est un défi que nous devons relever.
Un autre défi à cet égard est qu'il existe une sorte de politisation des objectifs du Concile Vatican II. Il y a un côté "progressiste" et un côté "conservateur". C'est quelque chose que le Concile ne recherchait pas, mais les gens ont décidé de politiser la liturgie et d'en faire une question politique, au lieu d'être le vaisseau de la vérité à partir duquel nous apprenons notre foi. Cependant, j'espère que nous reviendrons à cette idée que la musique est un compagnon de la liturgie et que nous pourrons écouter cette tradition reçue lorsque nous examinerons la prière de l'Église.
Pensez-vous que le débat que nous avons actuellement dans l'Église sur le Novus Ordo et la messe traditionnelle va affecter la prière dans l'Église et le chant grégorien dans la liturgie ?
-Il y a beaucoup de critiques à ce sujet. Certains pensent que ceux qui soutiennent la messe traditionnelle sont coincés et irréalistes. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit ce qui motive les gens qui viennent à la messe traditionnelle. Je pense que dans ce rite, ils entendent la voix de l'Église d'une manière particulière et que cela les touche d'une manière que le Novus Ordo ne fait pas.
Mais je pense que l'Église est toujours une seule voix. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain, il n'y a qu'un maintenant dans lequel l'Église prie, c'est le Christ qui prie aujourd'hui à travers la liturgie. C'est le Christ qui prie aujourd'hui à travers la liturgie. Il est ici maintenant en train de prier avec et comme l'Église, parce qu'il en est la tête. Si nous gardons cela à l'esprit, peut-être que le débat sur le passé, le présent et l'avenir pourrait se calmer un peu.
En ce qui concerne l'incidence de cette question sur la prière, le pape Benoît XVI a eu une très bonne idée à ce sujet lorsqu'il a déclaré que l'ancienne forme doit informer la nouvelle forme dans la liturgie. Ces deux choses doivent être considérées comme compatibles et non comme opposées.
La musique elle-même est un lien entre le Novus Ordo et la tradition. Si nous décidons que nous avons besoin d'une musique totalement différente pour une nouvelle liturgie, nous aurons perdu une partie du lien avec l'idée que nous avons reçu la liturgie de l'ancienne Église.
Le chant grégorien n'est pas aussi ancien que la prière des apôtres, c'est vrai. On ne sait pas vraiment d'où il vient ni quand il a commencé. Cependant, plusieurs théories affirment que des formules de prières juives ont influencé son développement. Sachant cela, si vous pouviez entendre comment les apôtres, qui étaient juifs, priaient, ne voudriez-vous pas en savoir plus ?
En tant qu'expert dans ce domaine, quels sont les défis auxquels le chant grégorien est confronté dans le contexte de l'Église contemporaine ?
- Depuis un siècle et demi, nous pouvons observer une sorte de haine du passé. Je pense même que certains catholiques ont compris que nous ne devrions pas être particulièrement attachés au passé, parce qu'alors nous ne vivons pas dans le présent et nous ne faisons pas face aux véritables défis de notre époque. Cet attachement démesuré n'est pas sain, mais il n'est pas sain non plus de ressentir de la haine envers le passé, car il est essentiel de comprendre qui l'on est et d'où l'on vient.
En matière de liturgie et de musique sacrée, la chose la plus importante pour comprendre la liturgie est son histoire. Et quelle est l'histoire de la liturgie ? L'histoire de la musique. Il faut les connaître ensemble, car la musique et la liturgie sont une seule et même chose, elles ne se sont pas développées indépendamment l'une de l'autre.
Au 20e siècle, cette idée que la musique et la liturgie sont deux mondes différents s'est enracinée. Mais les historiens nous montrent que c'est faux et qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de la liturgie sans comprendre l'histoire de la musique.
Pour tout cela, nous devons perdre la crainte que si nous regardons notre passé, nous échouerons d'une manière ou d'une autre dans notre présent. Cette crainte n'est pas rationnelle. Si je ne comprends pas et ne valorise pas le passé, cette histoire que nous avons mentionnée, je n'ai rien à faire avancer. Par conséquent, je suis obligé d'inventer constamment la réalité.
Nous ne pouvons pas oublier que la religion nous relie au passé, nous ne pouvons pas être religieux sans porter le passé avec nous.
Avec ce défi à l'esprit, nous devons savoir que le chant grégorien n'est pas seulement ancien, mais qu'il se régénère au fil du temps. Il n'est pas figé, il évolue. Il est essentiel que les musiciens comprennent cette idée et l'intègrent à leur formation.
Quelles mesures peuvent être prises pour préserver la pratique du chant grégorien dans la liturgie ?
- Je pense qu'il est important de reconnaître que le chant grégorien a plusieurs niveaux. Il y a le niveau de la congrégation, puis un niveau plus développé, auquel la congrégation peut participer mais qui nécessite plus de pratique. Enfin, il existe un niveau de chant grégorien réservé aux personnes plus expérimentées.
Pour moi, c'est une belle chose, car cela reflète la liturgie elle-même. Dans la liturgie, il y a des choses que seuls les "experts", les prêtres, peuvent faire. En d'autres termes, la liturgie est hiérarchisée, tout comme la musique.
Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque de la Réforme, cette hiérarchie a été brisée. Par conséquent, pour aller de l'avant, nous devons reconnaître que le chant grégorien est hiérarchisé, tout comme la liturgie, et que nous avons donc besoin de musiciens spécialisés. Nous devons également promouvoir la pratique du chant dans la congrégation afin qu'elle puisse chanter des choses telles que le Credo, le Kyrie Eleison ou l'Agnus Dei.
Un autre aspect à prendre en considération, sur lequel les avis divergent, est l'ouverture à chanter dans la langue vernaculaire. Je pense qu'il est possible de traduire des pièces musicales dans d'autres langues, mais il faut beaucoup de discipline pour ne pas perdre la beauté originale.