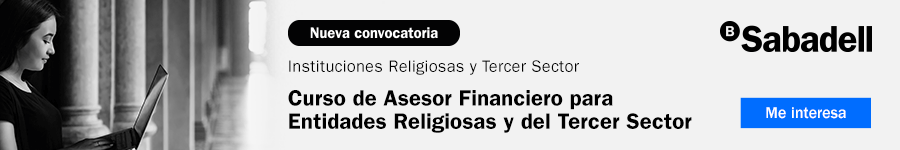L'Assemblée pour une Église synodale (communion, participation et mission) n'est pas terminée. En plus des travaux des 12 groupes mandatés par le Saint-Père pour être complétés d'ici juin 2025, il revient maintenant aux diocèses, aux conférences épiscopales et à toute l'Église de les mettre en œuvre.
Mgr Alain Faubert, 59 ans, nouvel évêque de Valleyfield (Québec), a été élu par le récent synode, le 24 octobre, membre du Conseil ordinaire du Secrétariat du Synode, en charge de ces assemblées. Omnes a assisté à une conférence que Mgr Faubert a donnée aux prêtres canadiens le 5 décembre, organisée par le Cercle sacerdotal de Montréal. En voici un résumé.
Processus d'écoute
Mgr Faubert, qui participait à son premier synode en octobre, a été impressionné, tant par la démarche même d'écoute du peuple de Dieu que par les conclusions. Le pape les a immédiatement approuvées, les déclarant partie intégrante de son magistère ordinaire ; comme on le sait, François ne publiera pas d'exhortation apostolique post-synodale.
Dans le document final du synode se retrouvent les idées, les opinions et les conclusions de sa propre table ronde, et bien sûr celles issues des autres conversations tenues dans la salle synodale. « C'était un synode d'évêques », a-t-il déclaré, »puisque la plupart d'entre nous étaient des évêques. Mais nous écoutions. Cela devrait toujours être le cas dans l'Église et dans chaque paroisse. Il a déclaré qu'il était important que tous les participants à ces tables rondes aient la même possibilité et le même temps de parole.
« Je viens d'être installé » (dans un diocèse, à l'ouest de Montréal; dans la métropole, il était évêque auxiliaire depuis 2016). « Quand on me demande quel est mon plan pour le diocèse de Valleyfield, je réponds que je veux d'abord écouter. »
Dans son émouvante conférence, il a noté comment l'Esprit Saint a soufflé sur ce dernier processus synodal universel, qui a duré trois ans. Saint Paul VI voulait que tout le peuple de Dieu soit impliqué dans les synodes. Dans son discours de clôture, le 26 octobre, François a confié aux quelque 400 participants que ce texte final, « sans le témoignage de votre expérience », perdrait beaucoup de sa valeur.
L'abbé Raymond Lafontaine, présent à la conférence, a corroboré les propos de Mgr Faubert ; il a été l'animateur expert de l'une des 36 tables de 12 membres chacune.
La retraite de deux jours qui a précédé le début du Synode a établi le bon contexte spirituel d'attention à ce que l'Esprit s'apprêtait à souffler. Il s'agissait de conversations dans l'Esprit. S'exprimant sur le processus synodal, M. Faubert a souligné qu'en dépit des imperfections humaines, nous devons croire que l'Esprit est à l'œuvre. Comme autres idées qui ont émergé de la conférence, notons par exemple : « Notre leadership en tant que prêtres doit être synodal : si nous n'agissons pas ainsi, si nous n'écoutons pas, la pastorale est bloquée. Les choses ne marchent pas. Nous avons un pape qui nous invite à dire les choses telles que nous les voyons : avec parresia, qui est l'audace dans la charité ».
Il faut, en droit canonique, proposer des choses très concrètes sur les conseils diocésains, les conseils pléniers et particuliers ; il faut « fonder, donner des pieds et des mains aux propositions synodales », il faut voir les aspects pratiques de la mise en œuvre. « Nous devons boucler le cercle». « Cette fraternité que nous avons vécue au Synode n'est pas anecdotique, elle doit être reproduite ici, mutatis mutandis».
Faits marquants
Selon l'évêque de Valleyfield, il est clair que la synodalité est un aspect fondamental et constitutif de l'Eglise. Fondée sur le baptême, elle est le modus vivendi et operandi de l'Église : voirLumen Gentium31-32. Elle doit être prise au sérieux : nous sommes tous égaux en dignité ! Nous devons savoir ce que pense le saint peuple de Dieu, ce que pense mon frère ou ma sœur - y compris ceux qui ne pratiquent pas ou ne sont pas dans l'Église (leurs cris doivent être reconnus).
Ensuite, nous devrions créer des processus concrets de discernement, de prise de décision et de responsabilité. Il devrait y avoir plus d'événements similaires aux synodes diocésains.
Citant le numéro 47 du document final, Mgr Faubert a souligné la dimension prophétique de notre synodalité ecclésiale pour un monde en proie à tant de divisions et de polarisations : des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de dialogue.
Mais l'Église synodale n'est pas un club social, elle a une mission qui sera féconde -- si elle est synodale. Il n'est pas bon de jeter des journaux devant des portes closes. Jésus va voir Zachée avant qu'il ne se convertisse, et Zachée est aussi un fils d'Abraham. Il a donné la moitié de ses biens aux pauvres ; nous aussi, nous trouverons de nombreuses surprises positives parmi les non-croyants. Le profil de l'Église est fondamentalement fraternel. Mes frères ne sont pas les autres évêques, ce sont les baptisés. Nous sommes tous des fidèles, ordonnés ou non.
Dialogue avec d'autres cultures
« Écoute, rencontre, dialogue. Autres religions, autres cultures. Moins chercher à avoir raison ou convaincre, plutôt témoigner de l'amour, servir humblement, surtout les exclus. Une Église qui se montre moins patriarcale, paternaliste et cléricale. Une Église qui s'engage dans la voie du Concile Vatican II pour l'unité et la réconciliation.
Les médias ont dit qu'il s'agissait d'un synode sur l'avenir de l'Église ; après tout, il s'agissait d'un synode sur l'avenir du monde ! Comment l'Église, en retrouvant une composante fondamentale de son être, pourra-t-elle offrir cet avenir de bonheur que Dieu veut pour le monde ? Comment l'Église peut-elle être un meilleur serviteur de ce monde ?
L'idée de la conversion traverse le document final, car la conversion est l'ADN de l'Église. L'orateur a suggéré de lire attentivement ces numéros : sur la conversion, la prise de décision et la responsabilité, 84, 93, 106, et il a ajouté : 27 (liturgie), 33 (très important), 47-48, 60, 65 (charismes), 68-74 (ministres ordonnés), 77 (plus grande participation des laïcs), 91 (comment consulter), 94, 104....
Il a souligné que les femmes qui ont participé l'ont fait avec sagesse, réflexion et détermination - elles n'étaient pas vindicatives. De nombreux théologiens et canonistes ont excellé, tout comme de nombreux délégués fraternels (non catholiques) dont l'expérience de la synodalité dans leurs traditions spirituelles s'est avérée précieuse. « Je me souviens d'un évêque anglican qui nous a demandé de ne pas oublier la Vierge Marie. Et le grand protagoniste a été le Pape.
Au terme d'une passionnante conférence, Mgr Alain Faubert a conclu en souhaitant que l'Église ne tourne pas la page de la synodalité, comme si elle avait terminé quelque chose. En tant que membre du Conseil ordinaire qui conseille le Secrétariat du Synode, et donc indirectement le Souverain Pontife, notre conférencier est convaincu que les conclusions de l'Assemblée XVI doivent être mises en œuvre avant de commencer à penser à l'Assemblée XVII. Le 17 décembre, ce Conseil international, composé de 12 évêques élus et de 5 autres membres nommés par le pape, dont deux femmes, a tenu sa première réunion Zoom.