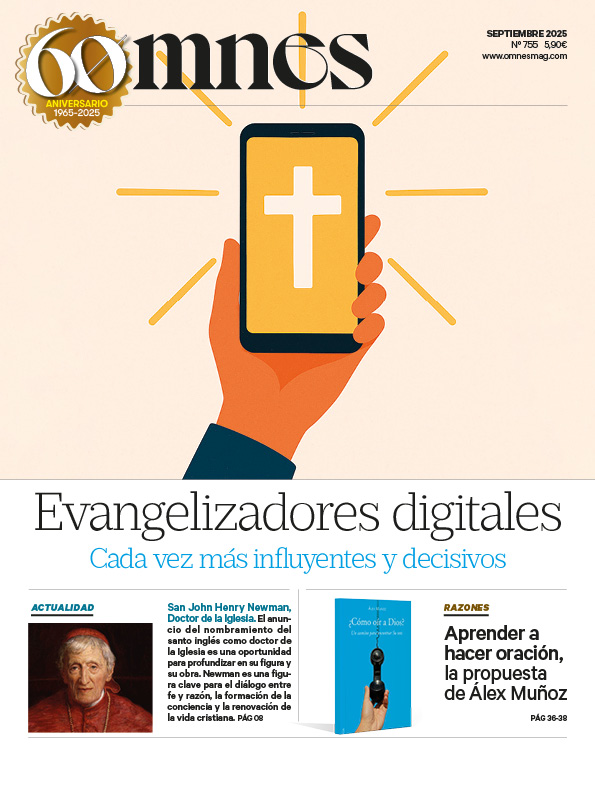Le Sahara occidental est l'un des conflits territoriaux les plus anciens et les plus complexes de l'histoire contemporaine, qui remonte à l'époque coloniale. Cette région était en fait une province espagnole connue sous le nom de Sahara espagnol et a été revendiquée en 1975 (fin de la domination coloniale espagnole sur la région) par le Maroc et la Mauritanie.
La question du Sahara occidental
La région a toujours été habitée par le peuple sahraoui, qui parle la langue arabe "Hassaniya" (une forme particulière d'arabe maghrébin qui diffère en partie du marocain) et appartient au groupe ethnolinguistique des Maures (Berbères arabisés).
Dès 1973, le Front populaire de libération de la Saguia el Hamra et du Rio de Oro avait été créé dans le but d'obtenir l'indépendance de la région. En 1975, suite à la Marche Verte (manifestation de masse organisée par le gouvernement marocain pour obtenir l'indépendance de la région sahraouie vis-à-vis de l'Espagne et son rattachement au Maroc), l'Espagne se retire de la région qui est alors envahie par le Maroc et la Mauritanie, ce qui déclenche un conflit armé avec le Front Polisario. En 1976, ce dernier proclame la naissance de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), reconnue par plusieurs pays et par l'Union africaine, mais pas par les Nations unies.
En 1979, la Mauritanie a renoncé à ses revendications sur le Sahara occidental, laissant au Maroc le contrôle de la majeure partie du territoire. Le conflit a duré jusqu'en 1991, date à laquelle les Nations unies ont négocié un cessez-le-feu et créé la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO), dans le but d'organiser un référendum pour déterminer l'avenir du territoire. Cependant, ce référendum n'a jamais eu lieu, en raison d'un désaccord entre les parties sur la composition de l'électorat et le mode de scrutin.
Le Maroc continue de considérer le Sahara occidental comme une partie intégrante de son territoire et a lancé une politique de développement et d'investissement dans la région. D'autre part, le Front Polisario continue de lutter pour l'indépendance et gère des camps de réfugiés sahraouis dans l'Algérie voisine, où de nombreux réfugiés vivent depuis des décennies (le Maroc est en désaccord avec l'Algérie principalement sur cette question, car l'Algérie a toujours soutenu le Front Polisario également dans le but de déstabiliser son voisin).
Des avancées diplomatiques importantes ont eu lieu ces dernières années, comme la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en 2020, en échange de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Cependant, la communauté internationale reste divisée sur la question et l'avenir du Sahara occidental est plus incertain que jamais.
Les Juifs du Maroc
Aujourd'hui, 99% de la population marocaine est musulmane sunnite. Cependant, une ancienne communauté juive, l'une des plus importantes du monde arabo-musulman, est présente dans le pays depuis des milliers d'années. Diverses légendes font remonter ses origines à l'époque de Josué. Les communautés qui vivaient déjà au Maroc depuis plusieurs siècles ont ensuite été renforcées par la vague de réfugiés israélites expulsés d'Espagne en 1492, qui ont apporté au Maroc la splendeur de l'âge d'or andalou.
Pendant des siècles, musulmans et juifs ont coexisté de manière productive dans le pays du Maghreb, et les Israélites, qui étaient encouragés par les dirigeants musulmans à vivre avec le reste de la population dans des quartiers mixtes, ont préféré vivre dans des quartiers séparés, qui ont pris le nom de "mellah", toponyme typiquement marocain pour désigner le terrain par lequel une partie de la ville de Fès était connue.
En 1764, le roi Mohammed III ordonne à de nombreuses familles de marchands juifs de s'installer dans la nouvelle ville de Mogador. Une nouvelle classe de marchands privilégiés s'est formée, qui a pris les rênes d'une vaste activité commerciale dans toute la Méditerranée. Malgré ce nouveau statut, les Juifs marocains, largement exclus de ce processus économique, ont continué à exercer des métiers traditionnels, en particulier l'artisanat.
Avec la conférence d'Algésiras de 1906, le territoire marocain est divisé en deux zones d'influence, l'une française et l'autre espagnole, et en 1912, deux protectorats différents sont établis.
Cependant, la partie nord (la partie française, c'est-à-dire le Maroc proprement dit) a continué à jouir d'un certain degré d'autonomie, de sorte que la communauté juive marocaine a été épargnée par les lois raciales appliquées dans le reste du Maghreb (Algérie et Tunisie) sous le régime de Vichy, le roi Mohammed V (le Maroc était un protectorat de la France) ayant refusé de les mettre en œuvre dans son pays.
Hormis le grave pogrom d'Oujda en 1948, suite à la proclamation de l'État d'Israël, qui a fait 40 morts parmi la population israélienne de la ville, après l'indépendance du Maroc en 1956, l'attitude des autorités marocaines à l'égard des Juifs a été, au moins dans une certaine mesure, louable. En effet, les Juifs marocains ont longtemps été considérés comme des citoyens comme les autres et donc moins influencés par la culture française que leurs coreligionnaires algériens et tunisiens. Ils parlaient principalement l'espagnol ou l'arabe, occupaient des postes importants dans le gouvernement et certains d'entre eux étaient membres de l'armée régulière.
Cependant, alors qu'en 1956 la population juive marocaine comptait 263 000 personnes, en 1961, date de la première véritable crise dans les relations entre juifs et musulmans, 40 000 juifs avaient déjà quitté le pays. L'émigration ne s'est arrêtée qu'en 1978, au point qu'il ne reste aujourd'hui que 2 000 à 3 000 Juifs dans le pays, dont la plupart vivent à Casablanca, Marrakech et Rabat.
Le christianisme au Maroc
Les chrétiens au Maroc sont une infime minorité, entre 20 000 (selon le Pew-Templeton Global Religious Futures, GRF) et 40.000 (selon le département d'État américain), ce qui n'est rien comparé à l'Antiquité (le christianisme est apparu au Maroc dès l'époque romaine, lorsqu'il était pratiqué par les Berbères de la province de Mauretania Tingitana, mais il a en fait disparu après la conquête islamique) et à l'ère coloniale (la présence européenne dans le pays a porté le nombre de croyants chrétiens à plus d'un demi-million, soit près de la moitié de la population de Casablanca, dont au moins 250 000 Espagnols).
Après l'indépendance en 1956, de nombreuses institutions chrétiennes sont restées actives, bien que la plupart des colons européens aient quitté le pays dans les années qui ont suivi. Malgré cela, la communauté chrétienne a pu continuer à exister principalement grâce aux expatriés et aux émigrés, surtout en provenance de l'Afrique subsaharienne : ils représentent une grande partie des fidèles chrétiens au Maroc, ainsi qu'un très petit nombre de Marocains convertis.
Il n'existe cependant pas de chiffres officiels, en partie à cause de la crainte de nombreux convertis de l'islam au christianisme. On parle de 5 000 chrétiens expatriés et de 3 à 45 000 convertis locaux (ce dernier chiffre est fourni par l'ONG Voice of the Martyrs, VOM), et la pratique de l'apostasie de l'islam se répand secrètement non seulement dans les villes, mais aussi dans les zones rurales.
La crainte de voir des apostats de l'islam se déclarer chrétiens découle à la fois des traditions religieuses (dans l'islam, l'apostasie est punie de mort) et des règles sanctionnées par le code pénal, qui interdit le prosélytisme et la conversion de l'islam à d'autres religions (autrefois plus fréquente, notamment sous le protectorat français), même si la dernière Constitution marocaine de 2011 stipule (article 3) que "l'islam est la religion de l'État", mais que l'État lui-même "garantit à toute personne le libre exercice de sa religion".
En effet, le code pénal marocain (qui considère toujours comme des crimes la rupture du jeûne en public pendant le mois sacré du Ramadan, les relations sexuelles hors mariage ou le blasphème) stipule, dans son article 220, que quiconque incite ou encourage un musulman à se convertir à une autre religion est passible d'une peine de prison de trois à six mois et d'une amende de 200 à 500 dirhams.
Ainsi, si l'apostasie n'est pas en soi un délit pénal (elle l'est pour ceux qui incitent un musulman à se convertir), elle entraîne une sorte de "mort civile", puisque l'apostat, selon le code de la famille du pays, est frappé d'une série d'empêchements graves, notamment en matière de mariage, de garde d'enfants et d'héritage. En effet, le mariage d'un musulman qui se convertit à une autre religion est dissous et le droit de garde et de tutelle de ses enfants est révoqué. Si l'apostat est donc une femme, elle ne peut avoir la garde de l'enfant que jusqu'à l'âge où elle a la capacité de discernement religieux. Quant à l'héritage, l'apostat n'a aucun droit à la succession, qui est garantie exclusivement aux héritiers musulmans.
Parmi les communautés chrétiennes, la plus importante est la communauté catholique, qui compte plusieurs paroisses, institutions caritatives et surtout des écoles dans tout le pays, en particulier à Casablanca, Rabat et dans d'autres grandes villes. Les églises protestantes et orthodoxes sont également présentes. Toutes les églises sont particulièrement engagées dans l'assistance et l'accueil des expatriés, mais aussi et surtout des réfugiés, des personnes déplacées et des immigrés, notamment subsahariens.
Ces dernières années, des efforts ont été déployés pour promouvoir le dialogue interreligieux. Le roi Mohammed VI a exprimé son engagement en faveur de la tolérance religieuse et de la coexistence pacifique entre les différentes communautés. la visite du pape François en 2019 ont souligné l'importance du dialogue entre musulmans et chrétiens pour favoriser la paix et la compréhension mutuelle.