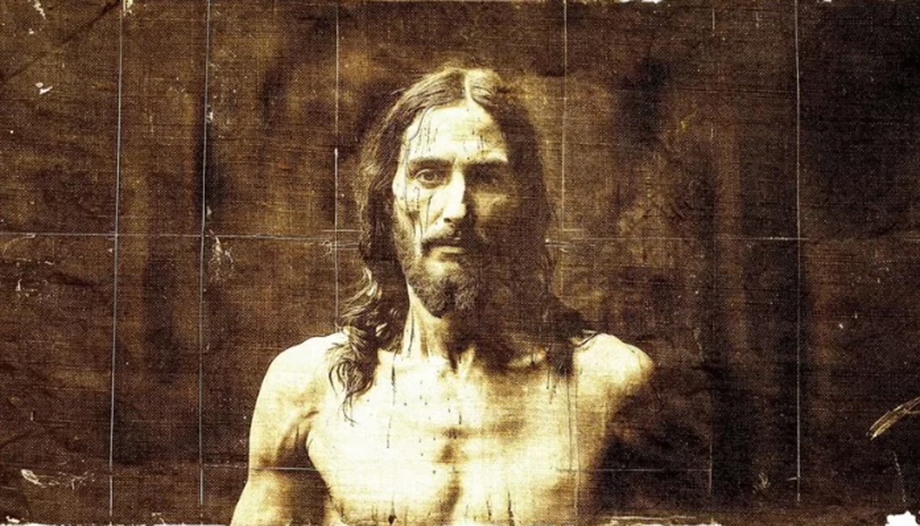Nous vivons à une époque de grande incertitude. Nous croyons souvent aveuglément ce que nous proposent les influenceurs sur les médias sociaux, sans creuser davantage. Pourtant, nous avons soif de vérité et de certitude.
Il en va de même pour la foi chrétienne depuis deux siècles : avec les Lumières et la sécularisation, de nombreuses choses considérées comme acquises ont été remises en question, au point de nier l'existence historique de Jésus de Nazareth, ainsi que son identité divine. Dans le même temps, on accorde du crédit à des historiens autoproclamés qui diffusent des théories sans sources ni fondements solides.
Pour ceux qui souhaitent aborder la figure historique de Jésus, nous ferons un tour d'horizon des sources et des méthodes de recherche sur le Nazaréen qui fait suite à une série d'articles déjà publiés par Omnes sur la vie de Jésus de Nazareth, son environnement culturel et géographique et sa mort.
Qu'est-ce que l'histoire ?
Commençons par définir ce qu'est l'histoire. Tout d'abord, il faut savoir que le terme dérive du grec ἱστορία (historia) qui signifie recherche, et a la même racine ιδ- que le verbe ὁράω (orao, voir, voir, verbe à trois racines : ὁρά- ; ιδ- ; ὄπ-). Le parfait ὁίδα, òida, signifie donc littéralement " j'ai vu ", mais, par extension, " je sais ". Il s'agit, en pratique, d'observer et, par conséquent, de connaître après avoir expérimenté : le même sens que l'on retrouve également dans la racine du verbe latin video (v-id-eo et dans le terme d'origine grecque "idée"). J'ajouterais, en outre, qu'une exigence de la recherche historique est, outre le sens critique, l'intelligence, au sens littéral du mot latin : intus lĕgĕre, c'est-à-dire lire à l'intérieur, approfondir, en conservant la capacité de considérer l'ensemble des faits et des événements.
La méthode historico-critique
Le siècle des Lumières a suscité des doutes sur la figure du Nazaréen, mais il a également donné une impulsion au développement de la recherche historique par le biais de la méthode historico-critique, qui vise à évaluer la fiabilité des sources. Cette méthode, développée depuis le XVIIe siècle, s'applique non seulement aux Évangiles, mais à tout texte transmis sous diverses variantes, afin de reconstituer sa forme originale et de vérifier son contenu historique.
Au cours des 150 dernières années, la nécessité de fonder historiquement la doctrine chrétienne a conduit l'Église catholique à réaffirmer fermement l'historicité des Évangiles, tandis que les historiens, les chercheurs et les archéologues ont utilisé la méthode historico-critique pour distinguer entre le "Jésus historique" et le "Christ de la foi". Cependant, une application trop idéologique de cette méthode a souvent conduit à une séparation nette entre le Jésus préchrétien et le "Christ de la foi". Pâques et le Christ d'après Pâques. Pour répondre à ces doutes, l'Église a approfondi l'étude exégétique et archéologique, réaffirmant lors du Concile Vatican II ("...") que "la réponse de l'Église à ces doutes est la même que la réponse de l'Église à la question de la mort du Christ".Dei Verbum") "affirme fermement et sans aucune hésitation l'historicité" des Évangiles, qui "transmettent fidèlement ce que Jésus, Fils de Dieu, pendant sa vie parmi les hommes, a réellement fait et enseigné pour leur salut éternel, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel".
La position de l'Église combine donc le "Jésus historique" et le "Christ de la foi" en une seule figure. Cependant, la grande majorité des historiens - chrétiens, juifs, musulmans ou non-croyants - ne doutent pas de l'existence historique de Jésus de Nazareth. Au contraire, les preuves historiques et archéologiques en sa faveur ne cessent de s'accumuler, renforçant la fiabilité des Évangiles et des autres écrits du Nouveau Testament.
L'approche du "Jésus historique
Aujourd'hui, la plupart des historiens s'accordent sur l'existence historique de Jésus, avec un nombre croissant de preuves historiques et archéologiques corroborantes. Cela s'explique par le fait que la recherche historique s'est développée autour de sa figure en trois phases principales :
- Première ou ancienne quête, initiée par Hermann S. Reimarus (1694-1768) et poursuivie par des érudits comme Ernest Renan, auteur de la célèbre "Vie de Jésus". Cette phase, influencée par le rationalisme éclairé, nie systématiquement tous les faits prodigieux liés à la figure de Jésus, sans remettre en cause son existence. Elle s'est cependant rapidement heurtée à ses propres limites idéologiques, comme l'a souligné Albert Schweitzer. En effet, aucun des protagonistes de cette phase de recherche n'a jamais prêté attention au contexte historique et aux sources archéologiques, même si Renan lui-même a parlé avec romantisme de la Palestine comme d'un "cinquième évangile".
- Nouvelle Quête ou Seconde Quête, officiellement initiée en 1953 par le théologien luthérien Ernst Käsemann, mais en réalité déjà initiée par Albert Schweitzer, qui avait souligné les limites de la première. Elle s'oppose à une phase antérieure, appelée No Quest, défendue par Rudolf Bultmann, qui était convaincu que la recherche historique sur Jésus n'était pas pertinente pour la foi chrétienne. La Seconde Quête a rejeté l'idéologie du "Christ de la foi", en adoptant une approche plus critique et intégrative, qui inclut les événements prodigieux sans les exclure a priori.
- Troisième recherche, prédominante aujourd'hui.
La troisième quête
Alors que la première quête était conditionnée par l'idéologie rationaliste et que la deuxième quête a introduit une approche plus équilibrée, la troisième quête se caractérise par une plus grande attention au contexte historique et à l'interdisciplinarité, combinant la philologie, l'archéologie et l'herméneutique. Aujourd'hui, grâce à cette méthode, nous disposons d'une image de plus en plus solide de l'existence historique de Jésus et de son importance dans l'histoire du premier siècle.
Les tenants de cette troisième quête partent de l'hypothèse formulée par Albert Schweitzer : on ne peut pas rejeter idéologiquement tout ce qui, dans les Évangiles et le Nouveau Testament, a un caractère miraculeux, en l'écartant parce qu'il n'est pas conforme aux canons du rationalisme éclairé. De plus, comme l'ajoute Benoît XVI (un représentant de la Troisième Quête, avec des auteurs et des scientifiques tels que les Italiens Giuseppe Ricciotti et Vittorio Messori, le Juif israélien David Flusser et l'Allemand Joachim Jeremias) dans son livre Jésus de Nazareth, les limites de la méthode historico-critique consistent essentiellement à "laisser le mot dans le passé", sans pouvoir le rendre "actuel, aujourd'hui" ; à "traiter les mots qui sont devant nous comme des mots humains" ; enfin, à "subdiviser encore les livres de l'Écriture selon leurs sources, mais l'unité de tous ces écrits en tant que Bible ne résulte pas d'un fait historique immédiat".
La troisième quête recourt à l'analyse textuelle et à l'herméneutique afin de se rapprocher le plus possible de la forme originale des sources considérées (en l'occurrence celles relatives à Jésus) et comprend, comme nous l'avons dit, des chercheurs tels que le juif israélien David Flusser (1917-2000), auteur d'écrits fondamentaux sur le judaïsme ancien et convaincu, comme beaucoup d'autres juifs contemporains, que les évangiles et les écrits pauliniens représentent la source la plus riche et la plus fiable pour l'étude du judaïsme du second temple, convaincu, comme beaucoup d'autres juifs contemporains, que les évangiles et les écrits pauliniens représentent la source la plus riche et la plus fiable pour l'étude du judaïsme du Second Temple, étant donné la perte d'autres matériaux contemporains due aux destructions causées par les guerres juives (entre 70 et 132 ap. J.-C.).c.).
Dans les articles suivants, nous verrons comment cette méthodologie a déjà été appliquée par l'Église, au fil des siècles, aux sources historiques et archéologiques concernant la figure du Christ.