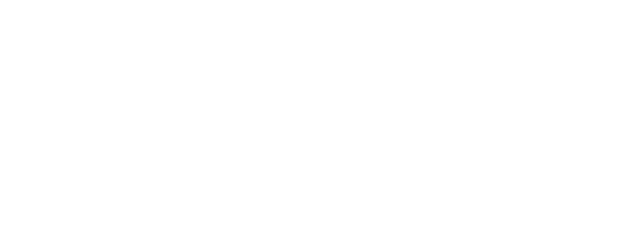Hernán vient de rentrer à Caracas de son internat en médecine. Il s'agit d'un voyage de sept heures par la rivière et de dix heures par la route depuis la mission de San Francisco de Guayo. Épuisé, il parle lentement, en pesant ses mots, comme quelqu'un qui a besoin de discerner entre les expériences et quelques sombres réflexions qui l'ont occupé durant ces mois.
La mission Guayo abrite quelque 1 500 indigènes Warao (peuple des canoës) qui vivent dans des palafitos (bâtiments sur pilotis sur des terres inondables) sur les rives du delta de l'Orénoque, à l'extrême est du Venezuela. Il y a un petit hôpital, une église, une école et peu d'autres choses. L'hôpital de la mission dessert une vingtaine de petites communautés dispersées dans un labyrinthe d'eau et de jungle. Ils ne parlent pas espagnol. Dans leurs palafittes sans murs, les Waraos n'ont pas d'autre eau potable que celle qu'ils recueillent lors des pluies. Ils se nourrissent de poissons, de tubercules et de maïs arepa.
Les Waraos sont les plus pacifiques des peuples indigènes précolombiens. Ils se sont dispersés dans le delta pour échapper aux tribus en guerre. Les hommes pêchent et les femmes s'occupent des enfants et fabriquent des objets artisanaux qu'elles vendent du mieux qu'elles peuvent. Malgré une enculturation croissante, le fossé entre les deux mondes reste énorme. C'est ce qui hante le jeune médecin lorsqu'il décrit ci-dessous la mission de Guayo.
Dans des conditions critiques
Il n'y a pas de médecin permanent dans le village. Seulement ceux d'entre nous qui sont stagiaires. La continuité des soins médicaux repose sur trois infirmières, dont deux sont des religieuses missionnaires capucines. L'hôpital général le plus proche se trouve à plusieurs heures de navigation. Parfois, nous voyons plus de cent patients par jour. Certains d'entre eux viennent en ramant pendant plus de trois heures depuis leurs campements dispersés dans le delta.
Petit à petit, nous prenions le contrôle de la situation. Ces communautés ont de sérieux problèmes de survie. Certaines ont été anéanties par deux maladies répandues : la tuberculose et le VIH.
Près de la moitié des enfants nés n'atteindront pas l'âge de cinq ans. La mortalité infantile très élevée est due à la déshydratation, principalement causée par les maladies diarrhéiques. En outre, l'eau apportée par les camions-citernes de l'État n'est pas saine.
La situation générale de pénurie dans les hôpitaux publics est cruellement exacerbée à Guayo. Les traitements contre la tuberculose et le VIH sont coûteux et rares.
Peu à peu, nous avons compris qu'il s'agissait d'un combat patient : nous devions maintenir l'illusion malgré les difficultés et faire tout ce que nous pouvions. Le site waraos ne sont pas très expansifs dans leurs expressions de gratitude. Nous avons d'abord été choqués, par rapport à ce qui se passe dans le reste du pays, où les patients reconnaissants ne manquent pas de rembourser le médecin d'une manière ou d'une autre. Mais même si nous ne comprenions pas totalement cette différence culturelle, nous étions animés par le désir de servir.
Nous avons eu de longues conversations avec les villageois. Nous entrions dans les palafitos pour partager et entrer dans leur monde. A Guayo, le temps s'écoule par intermittence. Il y a des périodes d'activité intense à l'hôpital ou dans les communautés extrêmes, et des heures très calmes au crépuscule.
L'attractivité du service
Toutefois, les perspectives ne sont pas sombres. Les difficultés sont mêlées d'espoir. C'est paradoxal, mais Guayo est un aimant pour les grands cœurs. Sur la rive opposée vit un couple de Français. Louis est médecin et Ada anthropologue. Ils sont dans le village depuis douze ans. Ils aiment le waraos et ils ont fait beaucoup de bien. Ils tenaient une auberge où ils avaient une station d'épuration qui alimentait également le village. Lorsque le tourisme a décliné, le gouvernement a confisqué l'usine. Maintenant, ils se contentent d'une minuscule installation.
Il n'y a jamais de pénurie de médecins stagiaires. Un après-midi, en revenant de ma tournée dans certaines des communautés dispersées le long des canyons, absorbé dans mes pensées, je suis presque tombé sur des enfants qui faisaient des dessins sur les planches des passerelles entre les palafitos. C'était un concours pour gagner des cadeaux pour les trois rois. Elle avait été organisée par Natalia, une étudiante en médecine qui était revenue de Caracas après son stage avec un chargement de vêtements, de médicaments et de jouets. Natalia a fait son stage de médecine dans une autre communauté, mais elle avait l'habitude de venir à Guayo pour donner un coup de main.
Tertiaires capucins de la Sainte Famille
La mission de San Francisco de Guayo a été fondée par le père Basilio de Barral en 1942. Érudit de la langue warao, il a publié un catéchisme et plusieurs ouvrages didactiques dans cette langue. Les missionnaires tertiaires capucins sont arrivés plus tard et ont donné une permanence à la mission.
Sœur Isabel López est arrivée d'Espagne très jeune, en 1960. Elle est venue avec des études d'infirmière et a travaillé pendant plusieurs décennies dans le delta. Elle a vu le village se développer et l'évangélisation s'étendre. Aujourd'hui, l'hôpital de Guayo porte son nom, mais cela n'a pas beaucoup d'importance pour elle. Sœur Isabel m'a fait une grande impression. En se promenant tranquillement dans le village, elle répand l'optimisme et l'espoir tout autour d'elle. Un après-midi, je revenais d'une tournée des communautés, dégonflé ; des images et des souvenirs grotesques déferlaient sur moi comme un nuage de moustiques dans une mangrove au crépuscule. Isabel m'a vu arriver et a joué à être un découvreur. Je ne me souviens plus très bien de ce qu'elle a dit, mais cela m'a redonné de l'enthousiasme. Je suis encore étonnée de l'habileté avec laquelle elle distribuait des bonbons aux enfants qui tiraient sur son habit pendant que nous bavardions.
Quelques confidences
Natalia a pu enregistrer certaines des confidences de Sœur Isabel dans une interview impromptue que je retranscris ici.
Dit la sœur : "Écoutez, sans l'amour de Jésus-Christ, je ne ferais rien. Jésus est le centre de ma vie consacrée, de ma vie spirituelle et de ma vie communautaire. Sans Lui, je ne ferais rien. Il est mon soutien, c'est pourquoi je suis ici, et regardez comme je suis heureuse, à l'âge que j'ai. C'est une chose extraordinaire. Écoutez-moi, docteur : si je renaissais, je serais un tertiaire capucin de la Sainte Famille et un missionnaire. Cent pour cent missionnaire, et avec le sourire, parce que j'ai toujours été très gaie et je n'ai jamais perdu mon sourire. Un peu plus vieux, oui, parce que tu es plus âgé, mais tu ne perds pas ton sourire.
La motivation initiale pour venir ici était l'évangélisation, pour faire des chrétiens, parce qu'il n'y avait rien à Guayo. Mes motivations actuelles sont toujours les mêmes, voire plus grandes. J'ai beaucoup d'espoir, beaucoup d'inquiétude pour les gens, pour ce que nous voyons à Guayo : la maladie, la pauvreté, les enfants qui meurent.
Certaines personnes reprochent aux missionnaires d'être trop paternalistes. Mais c'est plus fort que moi : un enfant vient chez moi et je ne lui donne pas un bonbon ? Les enfants et les personnes âgées sont ma prédilection. Et les petits me regardent et voient quelque chose : de l'affection. J'aimerais avoir beaucoup de choses à donner aux enfants, même si on dit que je suis paternaliste ou maternaliste.
Natalia a ensuite demandé à Sœur Isabel quelles avaient été ses peurs ou ses moments les plus difficiles. Elle a répondu comme suit : "Je n'ai pas eu beaucoup de moments difficiles, j'ai été très heureux et je me sens toujours heureux. Des moments difficiles ? Eh bien, voir une si grande pauvreté, voir des gens mourir. La rivière m'impressionne beaucoup. En voyant l'eau, on monte dans un bateau et on ne sait pas... J'ai connu de nombreux dangers sur le fleuve. Mais très peu de moments difficiles. J'ai été très heureux, très heureux, très dévoué.
Je ne suis pas fatigué. On dit qu'Isabel est un chardonneret. Mais j'ai soixante-dix-sept ans et parfois mes forces me font défaut. Cela se voit dans mon travail, mais bien sûr, très bien. Je ne me sens pas vieux. Je ressens la même chose. Je te disais : après 56 ans, j'ai l'impression que c'était hier et que je n'ai rien fait. Je n'ai pas quitté le Delta".
Un médecin dans le delta de l'Orénoque
Pour exercer la médecine au Venezuela, chaque étudiant doit effectuer une année d'internat supervisé. Ils sont généralement effectués dans des zones pauvres, mais il est possible de travailler en ville et de recevoir une certaine compensation financière. Il ne manque pas d'étudiants à la recherche des zones et des conditions les plus difficiles dans les périphéries.
Alfredo Silva a étudié la médecine à l'Université centrale du Venezuela à Caracas et est sur le point de terminer son stage auprès des populations indigènes du delta de l'Orénoque, dans cet enchevêtrement de canaux où le fleuve fond avant d'atteindre l'Atlantique. Nous lui avons posé quelques questions.
Pourquoi avez-vous décidé de faire votre stage ici ? -Je suis venu dans le delta pour la première fois pendant les vacances de Pâques 2006. C'était pour un programme de volontariat organisé par mon école. Nous faisions du travail social et des activités catéchétiques. L'endroit et les gens m'ont conquis.
J'y suis retourné pendant deux mois en 2014, lors de la sixième année de mon diplôme. J'ai amené Jan, un camarade de classe, avec moi. C'était très enrichissant. Nous nous sommes sentis utiles. Nous avons vu comment nos efforts ont porté leurs fruits. Nous pourrions aider beaucoup et donner des opportunités à ceux qui n'en avaient pas.
Début 2015, nous avons décidé d'y effectuer notre stage de fin d'études. Ce n'était pas facile. Nous étions à court d'argent. D'autres destinations offraient des avantages financiers, alors que venir ici nécessite de réunir des fonds et de toujours mettre quelque chose de son côté. Mais la médecine était devenue très proche de nos cœurs et nous poussait à servir. Depuis des années, j'envisage de rejoindre Médecins Sans Frontières, une ONG qui fournit une aide humanitaire dans les zones touchées par la guerre ou les catastrophes naturelles. Mais ici, nous avons été confrontés à des situations comparables à celles-ci en termes de mortalité, de conditions alimentaires et de maladies graves.
Comment vos motivations ont-elles évolué au cours de ces mois ? -Un professeur a suggéré que nous fassions pression pour une étude sur la tuberculose et le VIH qui ravagent ces communautés. L'aspect académique a calmé beaucoup de nos proches, qui s'inquiétaient des difficultés que nous allions rencontrer. Les résultats de l'étude pourraient nous donner accès à des études de troisième cycle.
Au fil des mois, la misère que nous rencontrions au quotidien a réaffirmé notre motivation à servir en progressant dans nos recherches. C'est le moyen d'affronter ce triste paradoxe : les Waraos vivent dans le dénuement du monde indigène, mais ils sont en proie aux maux de la société actuelle.
Quels ont été vos meilleurs moments ? -C'est quelque chose qu'on ne cherche pas. Au contraire, vous êtes surpris d'être heureux, épanoui, en travaillant dans les endroits les plus misérables. Le besoin des autres vous fait sentir utile.
Il y a quelques mois, nous avons rendu visite à une famille dont la mère et la fille souffraient de la tuberculose. Le fils aîné souffrait de malnutrition. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour obtenir le traitement médical requis, qui a mis du temps à arriver. Quand nous sommes revenus, seul le fils avait survécu. Dans ces conditions difficiles, nous avons pu sauver le garçon. C'est très dur, il faut du temps pour s'imprégner, mais cela peut aussi être très enrichissant.
Quelles ont été vos craintes ? -Lorsqu'on est témoin de situations aussi fortes, on a envie d'aider et de faire des choses. C'est la peur de ne pas pouvoir aider, parce que vous vous battez contre quelque chose qui vous dépasse. Cela implique une lutte constante pour rester motivé. C'est effrayant de penser qu'en partant, ça va finir par s'effondrer.
Les Waraos sont très réceptifs à notre aide, mais les ressources sont insuffisantes. Ils ont toujours besoin de plus. Si vous servez une communauté, elle attendra de vous que vous veniez tous les jours. Mais les médicaments sont limités. L'hôpital le plus proche est trop loin pour qu'ils puissent pagayer en canoë. Si je devais essayer de décrire les Waraos, je dirais qu'ils sont des survivants nés. Ils ont peu d'outils, mais beaucoup de patience pour faire face au monde d'aujourd'hui. Pourtant, ils luttent contre la joie et le charme simple de l'immaculé. Ils sont toujours confiants, nobles, accueillants.
Si tu remontais dans le temps, est-ce que tu y retournerais ? -Oui, bien sûr, absolument. Je ne regrette rien. Beaucoup de bonnes choses se sont produites et j'ai beaucoup appris. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de tant de choses pour vivre.
Caracas