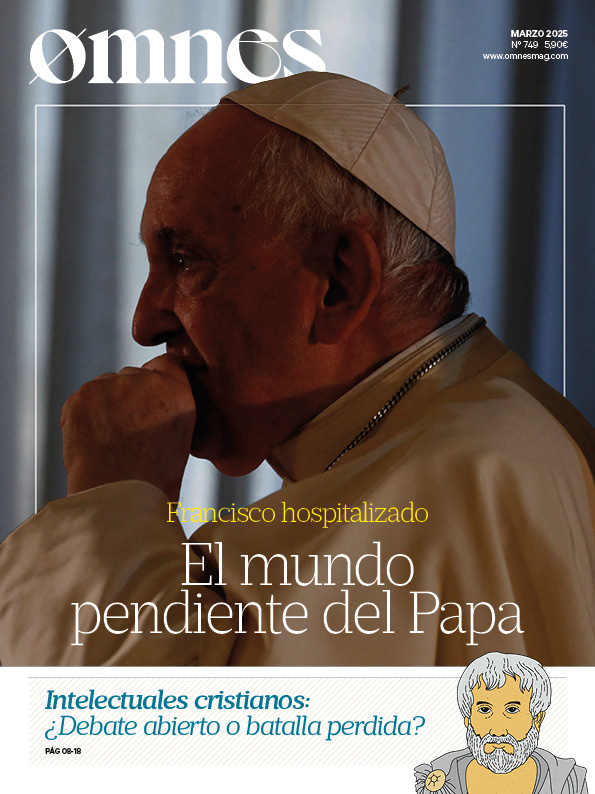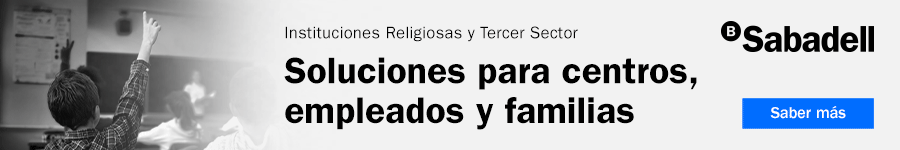Lorsqu'on m'a demandé si j'accepterais d'écrire un article qui expliquerait aux non-Africains le rôle de la musique dans les célébrations liturgiques en Afrique, le courriel que j'ai reçu me demandait de me concentrer sur trois points importants : " les raisons du chant ", " la danse " et " la durée des messes en Afrique " : "les raisons du chant", "la danse" et "la durée des messes en Afrique".
J'ai immédiatement pensé à une phrase que j'entends souvent ici en Europe : "Les Africains chantent et dansent pendant les célébrations liturgiques, et c'est pourquoi leurs messes durent si longtemps". Cette affirmation n'est pas tout à fait vraie, elle mérite donc d'être précisée. Pourquoi les Africains chantent-ils et dansent-ils pendant les célébrations liturgiques ? Les messes en Afrique durent-elles vraiment si longtemps ? En tant que fils de l'Afrique, j'ose répondre à ces questions.
Pourquoi chanter pendant les célébrations liturgiques ?
Il est très important de rappeler, tout d'abord, que l'Afrique n'a pas inventé sa propre liturgie. L'Église en Afrique suit les prescriptions de l'Église universelle en matière de liturgie et essaie toujours d'y être fidèle. L'Église, "peuple du Nouveau Testament", est le peuple de la Nouvelle Alliance scellée par le Sang du Christ, mais cela ne veut pas dire qu'il y a une rupture avec l'Ancien Testament. En d'autres termes, l'Église a intégré certains actes du culte du peuple d'Israël dans sa vie religieuse. liturgiecomme, par exemple, le chant.
Dans l'Ancien Testament, les psaumes constituent la quintessence du livre de prières. Les psaumes étaient destinés à être chantés. L'Église a conservé cette même attitude à l'égard des psaumes et les a utilisés plus que tout autre livre de l'Ancien Testament. D'ailleurs, dans les psaumes eux-mêmes, le psalmiste ne cesse d'exhorter le peuple à chanter le Seigneur Dieu (cf. Ps 95, 1-2 ; 45, 1 ; 92, 3-4 ; 104, 33, etc.) La fidélité à la liturgie sacrée exige que nous chantions pendant la liturgie, et nous, Africains, le faisons avec un cœur plein de joie.
Dans la Instruction générale du Missel romain (GIRM) parle de l'importance du chant. "L'Apôtre exhorte les fidèles, qui sont rassemblés pour attendre la venue de leur Seigneur, à chanter ensemble des psaumes, des hymnes et des chants inspirés (cf. Col 3,16). En effet, le chant est le signe de l'exultation du cœur (cf. Actes 2, 46). C'est pourquoi saint Augustin dit à juste titre : "Le chant est le propre de celui qui aime", tandis que le proverbe remonte à l'Antiquité : "Celui qui chante bien prie deux fois" (GIRM, n. 39).
Plus loin, le GIRM insiste pour donner une grande importance à l'usage du chant dans la célébration de la Messe, en tenant toujours compte de la culture du peuple et de la capacité de l'assemblée liturgique. Ainsi, le chant est l'un des éléments de la liturgie que l'Église a reçu de l'Ancien Testament et auquel l'Église en Afrique essaie d'être fidèle. Il n'est nullement en contradiction avec les normes de l'Église universelle. Le chant pendant la célébration de la messe est biblique et ecclésial.
L'Afrique et sa culture
Je voudrais insister sur l'aspect "culture" mentionné dans l'Instruction générale du Missel romain. Chaque personne a une culture, et la culture n'est pas statique, elle est dynamique. Elle change tout le temps. On est africain avant d'être chrétien. Même après le baptême, on est toujours africain. La deuxième raison pour laquelle les Africains chantent et dansent pendant la liturgie est qu'il est important de comprendre ce que le chant et la danse signifient dans la culture africaine. Cette culture comporte de nombreux éléments, dont la musique et la danse.
La description suivante de John S. Mbiti, ancien professeur d'études religieuses à l'université de Makerere à Kampala, en Ouganda, dans son livre "Introduction to African Religion", peut nous aider à comprendre quelque chose à la musique et à la danse africaines : "Les Africains sont très friands de musique. C'est pourquoi la musique, la danse et le chant sont présents dans toutes les communautés africaines. On trouve également de nombreux types d'instruments de musique, le plus courant étant le tambour. Il existe des tambours de formes, de tailles et d'usages différents. Certains tambours ne sont utilisés qu'en relation avec les rois et les chefs : ces tambours royaux sont souvent considérés comme sacrés et ne peuvent pas être joués couramment ou par n'importe qui. Il existe des tambours de guerre, des tambours parlants, des tambours de cérémonie, etc. Les autres instruments de musique sont les xylophones, les flûtes, les sifflets, les cloches, les harpes, les trompettes, les lyres, les arcs à bouche, les cithares, les violons, les crécelles et bien d'autres encore. Ils sont fabriqués en bois, en cuir, en calebasse, en bambou, en métal, en bâtons, en troncs d'arbre et même, de nos jours, en boîtes de conserve et en jerrycans. La musique est utilisée dans toutes les activités de la vie africaine : pour cultiver les champs, pêcher, élever les troupeaux, célébrer des cérémonies, louer les chefs et les guerriers, bercer les bébés pour les endormir, etc. La musique et la danse africaines se sont répandues sur d'autres continents (...) Elles constituent l'un des principaux trésors de la culture et du patrimoine africains.
Aimant beaucoup la musique, l'Africain comprend très bien l'esprit de la liturgie de l'Église. Il sait que les rubriques liturgiques recommandent que "l'on veille absolument à ce que les chants des ministres et du peuple ne manquent pas dans les célébrations qui ont lieu les dimanches et les jours saints d'obligation" (cf. GIRM, n. 40). Cependant, les Africains ne chantent pas pendant la liturgie pour promouvoir leur culture. La liturgie n'est pas un lieu pour promouvoir une quelconque culture ! Ils chantent parce que le chant est une autre façon de prier Dieu (cf. Ex 15,1-2 ; Ep 5,19-20 ; Jc 5,13 ; Ap 14,2-3). En Afrique, on a composé des chants liturgiques qui élèvent vers Dieu la prière de bénédiction et d'adoration, la prière de demande, la prière d'action de grâce et la prière de louange.
Examinons maintenant un autre aspect : les danses. Dans l'une de ses interviews en 2008, le cardinal Francis Arinze, alors préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, s'est vu poser la question suivante : "Y a-t-il un moment où il est permis de danser pendant la messe, et qu'en est-il de la musique profane ? Sa réponse fut très édifiante. Il a répondu : "La danse n'est pas connue dans le rite latin de la messe. Notre Congrégation y réfléchit depuis des années. Il n'y a pas de document majeur de l'Église à ce sujet, mais la directive que nous donnons de notre Congrégation est la suivante : dans la stricte liturgie (c'est-à-dire la messe, les sacrements), l'Europe et l'Amérique ne devraient pas parler de danse liturgique du tout, parce que la danse telle qu'elle est connue en Europe et en Amérique du Nord ne fait pas partie de l'adoration. Ils devraient donc l'oublier et ne pas en parler du tout. Mais c'est différent en Afrique et en Asie, non pas pour leur faire une concession, mais parce que leur culture est différente".
On peut donc parler de danse liturgique en Afrique et en Asie, mais pas en Europe et en Amérique. Un lecteur non africain demandera : "Mais pourquoi ? parce que la culture est différente. Mais en quoi cette culture est-elle différente ? Le cardinal poursuit : "Si vous donnez à un Africain typique les dons à porter lors de l'offrande et que vous donnez à un Européen typique les mêmes dons à porter, si vous ne vous voyez pas, l'Européen marchera assez raide jusqu'à l'autel ; l'Africain aura probablement des mouvements : à droite, à gauche. Ce n'est pas une danse ! C'est un mouvement gracieux pour montrer la joie et l'offrande. En Asie aussi, ils ont des mouvements raffinés qui témoignent du respect, de l'adoration et de la joie.
Le respect du sacré en Afrique
Avant l'arrivée du message de l'Évangile en Afrique, la religion traditionnelle africaine entourait chaque sphère de la vie d'un Africain. L'un des éléments remarquables de cette religion était la crainte révérencielle du "sacré". Où qu'un Africain se trouve, sa religion l'accompagne : à la maison, lors d'une réunion, dans les champs, etc. De ce fait, même les chants et les danses étaient respectueux, au point de constituer une partie importante des rituels.
Avec l'arrivée du christianisme, les danses africaines s'inscrivent naturellement dans la liturgie du culte du vrai Dieu. Mais il ne s'agit pas de "danse" au sens où l'entendent un Européen ou un Américain : une danse du samedi soir : un homme, une femme ! C'est une récréation qui ne peut en aucun cas faire partie du culte.
Je n'ai pas l'intention de "canoniser" les danses africaines et de faire comprendre que tous les styles de danse en Afrique ne sont pas en contradiction avec le caractère sacré de la liturgie. Pas du tout ! Même en Afrique, certaines danses ne sont pas acceptables dans la liturgie. Certaines ne sont pas acceptables lors d'un événement religieux. Les objectifs de la messe sont au nombre de quatre : l'adoration, la contrition, l'action de grâce et la demande ; et un Africain sait comment exprimer extérieurement ces attitudes par ses mouvements qui sont respectueux et en même temps catéchétiques.
Ce que les Européens et les Américains considèrent comme des "danses", et qui leur semble un peu étrange en raison de leur conception de ce qu'est une "danse", pourrait être appelé "langage corporel pendant la liturgie". En parlant de "langage corporel", je trouve très enrichissant un hymne anglais intitulé "Now Thank We All Our God", composé par Martin Rinkhart. Il s'agit d'un hymne d'action de grâce qui commence ainsi : "Now we all thank our God, with hearts, hands and voices..." (Maintenant, nous remercions tous notre Dieu, avec nos cœurs, nos mains et nos voix). La messe est la célébration de l'Eucharistie. C'est une action de grâce. Notre attitude intérieure pendant la Messe doit aussi se manifester à l'extérieur. L'être humain est corps et âme. Nous devons remercier Dieu "avec nos mains et nos voix". Sans exagérer, pendant la Messe, nos postures et nos gestes, nos chants et nos "danses" doivent manifester ce que nous croyons et nourrir notre foi.
"Danser" dans la liturgie
Peut-être que ma petite expérience en Europe peut aussi m'aider à expliquer ce que j'ai appelé "le langage corporel pendant la liturgie" pour expliquer pourquoi les Africains "dansent" pendant la liturgie. Ici, en Europe, les gens attachent beaucoup d'importance au sourire. Pourquoi ? La réponse est simple : parce que les actes sont souvent plus éloquents que les mots. Il ne suffit pas de dire "je vais bien", les gens veulent que vous montriez que vous allez vraiment bien, et qu'est-ce qui aide à le faire ? Un sourire ! Que se passe-t-il lorsque nous disons à Dieu que nous sommes reconnaissants, que nous le sentons, que nous l'adorons du plus profond de notre cœur ou que nous lui demandons une faveur ? N'est-il pas juste, devant Dieu, que nous le montrions aussi à l'extérieur par nos gestes et nos postures ?
Je trouve l'explication ci-dessus utile parce que souvent, lorsqu'on parle de ce qu'on appelle les "danses liturgiques", on pense à une célébration de la messe en Afrique comme à une sorte de "banquet" où les gens vont chanter et danser, transpirer et entrer dans une forme d'extase avant de rentrer chez eux le dimanche à midi. Il s'agit là d'une conception erronée. Les danses liturgiques dans les célébrations liturgiques en Afrique sont des mouvements raffinés qui doivent être compris dans le contexte des gestes et des postures liturgiques. Cela étant, ces mouvements sont orientés vers les quatre objectifs de la messe : l'adoration, la contrition, l'action de grâce et la demande. Les évêques de chaque pays y veillent et les danses qui ne répondent pas à cet objectif sont normalement interdites.
Les masses "longues" de l'Afrique
Enfin, parlons de la durée des messes en Afrique. C'est un grand débat parmi les catholiques non africains. Beaucoup disent que les messes en Afrique durent longtemps. Beaucoup d'Européens et d'Américains en parlent. Il est important de se poser quelques questions : les messes en Afrique durent-elles vraiment longtemps ? Si oui, pourquoi ? Est-ce édifiant ou non édifiant ? Est-ce lié à la culture africaine ? Combien de temps doit durer la messe ?
Sur mon continent, il y a de nombreuses paroisses où les prêtres célèbrent chaque dimanche trois ou quatre messes dans la paroisse : à 6h30, 8h30, 11h00 et éventuellement 16h00 avec les enfants. Ces messes dominicales de deux heures entrent-elles également dans la catégorie des "longues messes" ? Elles ne devraient certainement pas l'être !
Cependant, nous pouvons envisager un autre scénario. Une messe à l'occasion de l'ordination sacerdotale ou épiscopale qui commence par une procession à 9 heures et se termine à 14 heures. Je pense que ce deuxième scénario est celui envisagé par beaucoup de ceux qui parlent de longues messes en Afrique. Il faut être réaliste : en Afrique, les églises sont pleines de monde. Le nombre de chrétiens ne cesse d'augmenter d'année en année. Lorsque vous avez des fêtes comme les ordinations, le nombre est encore plus élevé car de nombreux invités viennent célébrer avec leurs proches. Une procession de 400 personnes prend donc plus de temps qu'une procession de 50 personnes. Ces personnes apportent ensuite leur offrande à la messe et beaucoup d'entre elles reçoivent la communion. Tout cela prend du temps, mais en réalité, c'est le temps qu'il faut ! Nous devons accepter que si certains célèbrent dans des églises vides, d'autres célèbrent dans des églises pleines de monde. Ce n'est pas une raison pour que certains soient tristes, nous croyons en une seule Église, sainte, catholique et apostolique !
Catéchèse et homélies
Outre le nombre de personnes assistant à la messe en Afrique, on a beaucoup parlé et on continue de parler de la longueur des homélies. Beaucoup disent que les messes en Afrique sont si longues parce que les prêtres prêchent beaucoup. Oui, je connais personnellement des prêtres qui prêchent pendant une heure lors des messes dominicales. S'il est vrai qu'une homélie n'est pas un cours magistral, la prudence pastorale ne devrait-elle pas guider un prêtre quant à la longueur de son homélie, compte tenu de la situation réelle de son troupeau ?
Dans de nombreuses régions d'Afrique, beaucoup de jeunes chrétiens suivent la catéchèse avant de recevoir les sacrements de l'Eucharistie et de la Confirmation et ne reviennent ensuite à la catéchèse que pour se préparer au sacrement du mariage. Dans cette situation, il faut faire attention à certaines idées qui peuvent ne pas être entièrement positives pour mes frères et sœurs africains.
Je pense que le cardinal Robert Sarah, prélat africain, a tout à fait raison lorsqu'il écrit dans son livre "Il se fait tard et il fait nuit" : "De quoi les fidèles vont-ils se nourrir s'ils n'écoutent qu'une homélie de dix minutes une fois par semaine ? Dire qu'au bout de dix minutes, les gens n'écoutent plus est un mensonge : si leur capacité d'attention est si courte, comment font-ils pour passer des heures et des heures devant la télévision ?
Peut-être est-ce lié à la culture africaine ? Il est important de souligner qu'en Afrique, une fête est vraiment une fête, tout comme un enterrement est vraiment un enterrement ! Un Africain sait comment consacrer son attention, son énergie, ses ressources et son temps pour s'assurer que de tels moments ne sont pas privés de leur plus grande importance. Il est donc raisonnable pour lui qu'une grande célébration comme une messe d'ordination sacerdotale ou épiscopale dure quatre ou cinq heures. Toutes les personnes présentes sont heureuses et personne n'est pressé lorsqu'il s'agit de tels événements. La qualité du moment est plus importante que le temps qui passe. En Europe, les gens pensent peut-être en termes quantitatifs. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux catholiques non africains s'étonnent de la durée des messes en Afrique.
Cependant, notre praxis n'est pas parfaite, tout comme aucune praxis n'est parfaite. Il peut y avoir des exagérations ici et là qui font que les messes en Afrique durent plus longtemps qu'elles ne le devraient. C'est là que la catéchèse doit jouer un rôle important et permettre ainsi de limiter la durée des homélies. Nous devons également apprendre à nos chers chrétiens à éviter les longues et bruyantes processions d'offrandes, agrémentées de danses interminables. Tout demande de la modération. Notre combat est de tout faire pour que tous ceux qui assistent à la messe participent à cette "actuosa participatio" (participation active) dont parle le Concile Vatican II. Bien sûr, cela n'a rien à voir avec le fait d'essayer d'argumenter sur le temps maximum autorisé pour une messe.